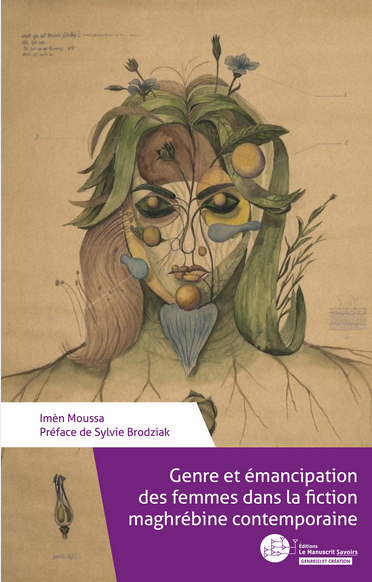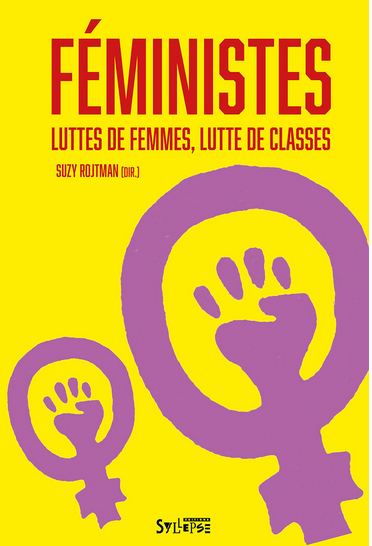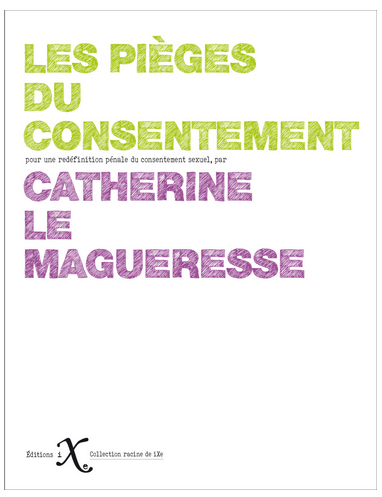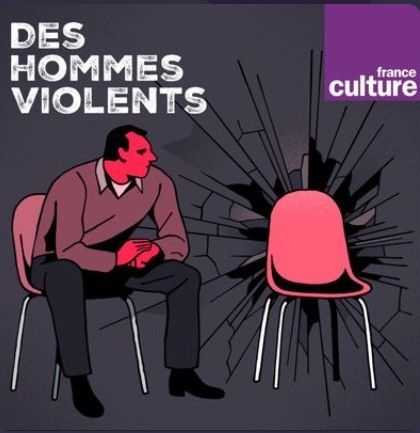
Des hommes violents
Sur France Culture, en 6 épisodes du 15/01/2020 au 02/03/2020
Immersion avec douze hommes condamnés pour violences conjugales et contraints par la justice de participer à un groupe de parole pendant six mois. Déni, témoignages, paroles de victimes. Un podcast documentaire en 6 épisodes de Mathieu Palain.
- Ecouter ICI

Le droit des femmes à vivre sans violence doit être fermement protégé
Un article de Heather Barr, Directrice adjointe, division Droits des femmes de Human Richts Watch (14 juillet 2025)
Le Comité de l’ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes souligne l’importance du droit international, face aux menaces croissantes

L’affaire de Mazan, statistiques et analyse
Statistiques établies sur la base des biographies des accusés publiées par Libération
- L'intégralité de l'étude (étude pour le site Irrédentiste ! ~ Blog féministe par Sporenda)

Inscrire le consentement dans la loi ?
Inscrire le consentement dans la loi sur le viol : l'idée divise
Alors que Gisèle Pelicot est interrogée pour la troisième fois mercredi dans le procès des viols de Mazan, la notion de consentement et de son intégration dans le Code pénal revient dans le débat public. Et les arguments s'opposent.

Sara Ahmed, philosophe : “La culture féministe est activiste”
Dans la newsletter de TELERAMA (le 20/03/2024)
Le mot « féminisme », écrit-elle, « me remplit d’espoir et d’énergie. Il évoque aussi bien des actes retentissants de refus et de rébellion que certaines façons tranquilles de ne pas nous accrocher à ce qui nous rabaisse… » Figure majeure de la théorie féministe et de la phénoménologie queer, Sara Ahmed arrive enfin en France. Depuis qu’elle a quitté l’université de Lancaster en 2016, cette philosophe anglo-australienne, née en 1969, expérimente des formes d’écriture plus accessibles et pratiques, comme en témoignent ces trois titres traduits en français, parus simultanément chez trois éditeurs différents : Manuel rabat-joie féministe (éd. La Découverte), Vivre une vie féministe (éd. Hors d’atteinte) et Vandalisme queer (éd. Burn-Août). Bien identifiée et souvent citée par les universitaires, sa pensée métaphorique peut désormais rencontrer un public plus large. Déployant des réflexions à la fois poétiques et franches, jouissives et percutantes, racontant son propre quotidien en tant que femme racisée ou transcrivant celui d’autres personnes, Sara Ahmed prend pour point de départ des expériences vécues dont elle tire des réflexions théoriques féministes. Elle cherche à proposer des modes d’action pour défaire les systèmes qui engendrent violences et inégalités…

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) publie son 6ème rapport annuel
Rapport annuel 2024
Pour la journée nationale officielle contre le sexisme, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) publie son 6ème rapport annuel sur l’état du sexisme en France et lance une nouvelle campagne de sensibilisation : « Faisons du sexisme de l’histoire ancienne ».
70 % des femmes estiment ne pas avoir reçu le même traitement que leurs frères dans la vie de famille, près de la moitié des 25-34 ans pense que c’est également le cas à l’école et 92 % des vidéos pour enfants contiennent des stéréotypes genrés.
Parallèlement à la publication du rapport annuel, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes lance une nouvelle campagne de sensibilisation : « Faisons du sexisme de l’histoire ancienne.
L’objectif est de sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs publics à la nécessité de lutter contre le sexisme.

En 2024, ne plus être courageuses ni formidables
Un article de Lola Lafon dans LIBERATION, le 7 janvier 2024
"N’attendez pas des femmes qu’elles changent seules les règles d’un système dont elles sont victimes, d’un ordre du monde qu’elles n’ont pas contribué à créer. Acceptez de voir vos certitudes, vos désirs questionnés. Agissez et prenez le relais. Mais le temps presse..."

« Le système des castes a besoin du patriarcat pour rester fort »
Un entretien paru sur le site CAPIRE, le 1 décembre 2023
En Inde, la déforestation et le patriarcat vont de pair ; par conséquent, le féminisme et l'écologie doivent également se construire ensemble.
Sehjo Singh fait partie de la Confluence des alternatives (en hindou, Vikalp de Sangam), une articulation d’organisations et de mouvements de défense de la nature, des communautés et de la souveraineté alimentaire en Inde. Sehjo a accordé cette interview lors de la 13e Rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes, à Ankara, Turquie. Lors de la rencontre, la présence de délégations de pays asiatiques parmi les militantes du mouvement et les organisations alliées était significative.
À l’occasion, Capire a parlé avec Sehjo de l’histoire de la construction du féminisme en Inde et des résistances et alternatives actuelles proposées par les femmes de la région. Selon Sehjo, les confrontations anti-patriarcales impliquent une critique du système des castes et de la lutte pour la terre, basée sur la réalité et les besoins des femmes populaires. Pour elle, la première bataille à mener est de reconnaître la centralité des agricultrices dans la production alimentaire et dans la garantie de la biodiversité : « Cela ne veut pas dire que les femmes contribuent — je dirais que ce sont les femmes qui la soutiennent’ »....

Le viol punitif : Violence envers les lesbiennes
Un article de Julie Bindel, le 12 septembre 2023
"Chaque nouvelle journée amène d’autres menaces violentes proférées par des hommes à l’encontre de lesbiennes. Une féministe du sud-est du Brésil m’a informée qu’une parlementaire (que j’appellerai Lorena, un pseudonyme) avait reçu des menaces de viol punitif (parfois décrit de manière inappropriée comme un « viol correctif »).
Un homme, qui prétendait avoir l’adresse de Lorena, lui a envoyé un message via les médias sociaux dont le sujet était « Le viol guérit les lesbiennes et je peux le prouver »...."
- L'intégralité de l'article (traduit de l'anglais)
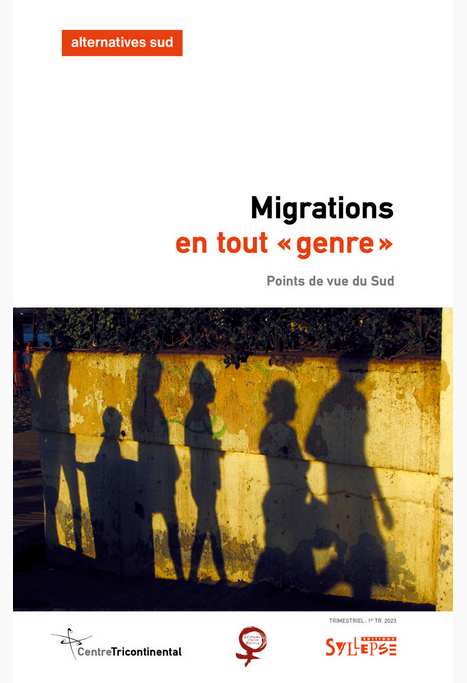
Le genre à la croisée des migrations et du travail
Texte publié par le site ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS (1 avril 2023) - Préface du livre Migrations en tout genre (Edition Syllepse)
Que fait le genre aux migrations ? Et en quoi les migrations agissent-elles sur le genre ? Ces questionnements ont rendu les femmes visibles parmi les migrants, révélé la dimension sexuée des flux migratoires et montré comme la division sexuelle du travail conditionne les possibilités d’emploi et de migration des femmes. Des opportunités existent, mais les normes de genre et les structures patriarcales demeurent résistantes aux changements.
Croiser les enjeux de genre et de migration est aujourd’hui une démarche courante dans le champ de la recherche. Non pas tant du fait que les femmes représentent presque la moitié des migrants internationaux, mais en raison de ce que fait le genre aux parcours migratoires, et inversement. Adopter l’approche genre signifie s’intéresser aux processus de différenciation et de hiérarchisation entre les sexes. Le genre divise, classe, hiérarchise l’humanité en deux moitiés inégales et interagit avec les catégories de classe, de « race », d’âge, de sexualité. Il structure les organisations collectives et les trajectoires individuelles, et génère des rapports de pouvoir complexes. C’est pourquoi il se déploie dans toutes les formes et à toutes les étapes de la migration, affectant différemment les hommes et les femmes dans les raisons d’un départ, dans les types de circulation, dans la ségrégation des marchés du travail, dans la gestion des frontières, dans les politiques migratoires et d’intégration, etc. ...

« Nos droits, c’est tout le temps et partout »
Un article de DIACRITIK, le 14 avril 2023? à propos de "Genre et émancipation des femmes dans la fiction maghrébine contemporaine" de Imèn Moussa
"Les éditions Le Manuscrit publient un essai, Genre et émancipation des femmes dans la fiction maghrébine contemporaine, occasion d’un grand entretien avec son autrice, Imèn Moussa. Imèn Moussa, née à Bizerte en Tunisie en 1987, a co-dirigé avec Jacqueline Brenot un numéro de Trait d’Union Magazine (Algérie) consacré aux femmes, « Ana Hiya : la femme maghrébine droit dans les yeux ». Elle est également co-fondatrice des Rencontres Sauvages de la Poésie en Île de France. Ses propres poèmes — Il fallait bien une racine ailleurs (L’Harmattan, 2020) — privilégient deux thématiques, le voyage et l’identité-femme ..."

LUTTES DE FEMMES, LUTTES DE CLASSES : comment les articuler ?
Interview de Suzy Rojtman par Francine Sporenda, parue sur le site ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS - 13 avril 2023
Suzy Rojtman est militante féministe depuis 1974, et a été dans la tendance lutte de classes du MLF. Elle a fait partie des « Pétroleuses » et est co- fondatrice en 1978 des « Radioteuses » et des « Nanas Radioteuses », radio libre féministe. Egalement co-fondatrice en 1985 du Collectif féministe contre le Viol et co-fondatrice en 1996 du Collectif National pour les Droits des Femmes. Elle vient de publier « Féministes ! Luttes de femmes, luttes de classes » (ouvrage collectif) aux éditions Syllepse.

50 ans après : bilan de la « Révolution sexuelle »
Entretien avec Malka Marcovich , paru le 12 mars 2023 sur le site Révolution féministe
Malka Marcovich est historienne, écrivaine, féministe engagée depuis plus de 40 ans, consultante internationale droits humains et droits des femmes, autrice de nombreux rapports et ouvrages de référence qui tentent de mettre en lumière l’omerta qui règne dans nos sociétés.

La grande histoire du féminisme
Numéro spécial n°63 - juin/juillet 2021 de la revue SCIENCES HUMAINES
Depuis ses origines, le mouvement féministe a déployé une énergie phénoménale pour défendre les droits des femmes. Les militantes ont dû faire preuve de courage, de ténacité et de créativité. La recette de leur succès tient en grande partie à la diversité des rhétoriques et aux mobilisations originales qu’elles ont déployées.
Le féminisme se veut pluriel dès son commencement. Il s’inscrit dans les courants de pensée de son temps : libéral, socialiste et révolutionnaire ; différentialiste, marxiste ou matérialiste à l’heure des théories de la domination sociale ; lesbien, égalitariste, du care, écologique, transhumaniste, queer de nos jours, avec le triomphe des quêtes identitaires.
Avec les contributions de :
Michèle Riot-Sarcey, Françoise Thébaud, Anne Cova, Bibia Pavard, Justine Zeller, Florence Rochefort

“Les Femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes?”
Un entretien paru le 23 mars 2023 sur le site ChEEk, Hanane Karimi révèle les liens entre islamophobie et patriarcat.
Dans un essai sans concession qui pose les questions qui fâchent, Hanane Karimi met en exergue la déshumanisation des femmes musulmanes qui portent le voile. Les Femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes?, s’interroge la maîtresse de conférence en sociologie à l’université de Strasbourg, avec un titre qui emprunte à bell hooks et Sojourner Truth, ces deux grandes figures de la lutte féministe et anti-raciste aux États-Unis. En questionnant les lois encadrant le port du foulard en France, et en développant l’idée que les femmes musulmanes y incarnent une “féminité paradoxale”, l’autrice désigne sans détour le plus grand oppresseur de ces dernières: un patriarcat qui ne se situe pas forcément là où l’inconscient collectif l’envisage.
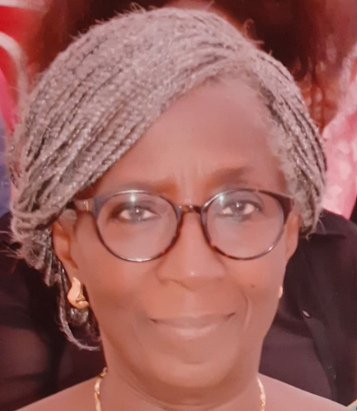
Les enjeux du féminisme au Sénégal
Intervention de Fatou Sow à lors du lancement du Réseau des féministes du Sénégal
"J’éprouve une vraie grande joie et un certain soulagement à participer à ce lancement du Réseau des féministes du Sénégal, pour deux raisons majeures. La première raison, c’est la volonté d’organisations féminines de se déclarer féministes, féministes sans si, ni mais, comme le décline la Charte des principes féministes pour les féministes africaines, élaborée en 2009, par le Forum féministe africain, mouvement panafricain de femmes, créé à Accra en 2006.
La seconde raison est la volonté de se mettre en réseau, après des séries de débats, ce qui n’est pas toujours évident. En effet, nous traversons des contextes souvent difficiles où de multiples défis, des divergences d’opinions, des contradictions idéologiques, des rapports de pouvoir et de leadership tendus, ..."

Un site algérien recense les féminicides dans le pays
Qui sommes-nous ?
Nous sommes deux militantes féministes algériennes, réunies par la nécessité d’alerter la société et les institutions face aux féminicides dans notre société et leur banalisation.
Nous effectuons un recensement qui consiste en une veille permanente de l’actualité nationale relative aux meurtres et assassinats de femmes et de filles, parce qu’elles sont femmes et filles. Nous tenons également à mettre en avant que ces féminicides ne viennent pas de nulle part, c’est le résultat d’une violence sociale et institutionnelle banalisée voire encouragée et entretenue.
Le recensement que nous réalisons suit plusieurs étapes : détecter le féminicide sur la presse ou les réseaux sociaux, chercher l’entourage de la victime et entrer en contact avec eux, confirmer l’information avec plusieurs personnes de son entourage, minimum 5 personnes, analyser les informations que nous avons, et en dernier lieu, rendre l’information publique. Nous avons ce besoin de contacter son entourage car nous avons constaté que dans la presse il n’y a pas assez de détails que nous jugeons nécessaires pour traiter ce sujet : age, nom de la victime, si la victime était déjà violentée, si elle a déjà essayé de demander le divorce ou de déposer plainte, si elle avait des enfants, sa fonction, entre autres. Nous aspirons ainsi à comprendre et analyser les mécanismes qui mènent aux féminicides...
- La suite
ICI

Féminicides au Maroc
Un entretien avec Camélia Echchihab, journaliste franco-marocaine (parution dans LA TRIBUNE, le 9 mars 2023)
Camélia Echchihab : J’ai 31 ans et je suis journaliste indépendante franco-marocaine. J’habite à Casablanca, et j’ai lancé en janvier dernier une page sur Instagram qui s’appelle « Féminicides.Maroc » où j’ai commencé à recenser les féminicides au Maroc. J’ai travaillé dans la presse écrite en France pendant 7 ans, et je couvrais surtout des histoires sur les violences sexistes et sexuelles à l’égard des femmes.
Lorsque je suis rentrée au Maroc, en 2021, j’ai commencé à m’intéresser à ce qui se passait dans la sphère féministe du pays. Je me suis rendu compte que les choses avaient énormément bougé. Des comptes féministes engagés ont fleuri sur les réseaux sociaux et ça m’a vraiment donné espoir. Je ne dis pas qu’à l’époque où j’étais au lycée, il n’y avait pas d’activisme féministe. Des associations agissaient déjà beaucoup, c’est à elles que nous devons en partie la Moudawana de 2004. Mais aujourd’hui, on observe un renouvellement de cet activisme, dans le sillage de #MeToo et grâce aux réseaux sociaux...
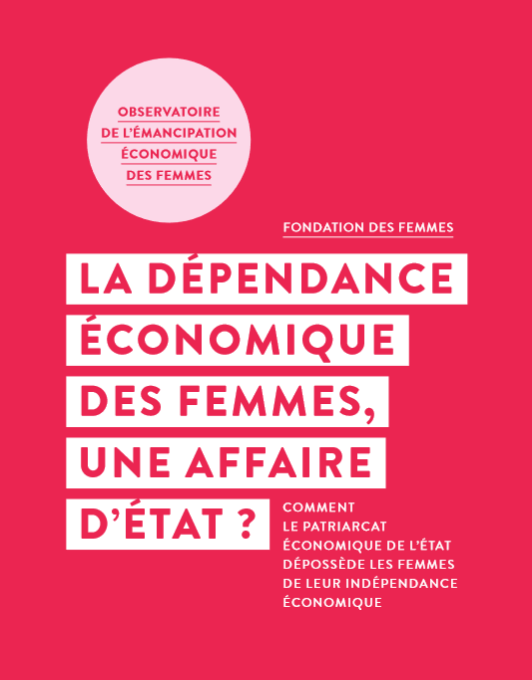
La dépendance économique des femmes, une affaire d'état ?
Une note de L'Observatoire de l'émancipation économique des femmes
La Fondation des femmes lance un Observatoire de l’émancipation économique des femmes et présente une note très convaincante sur « l’individualisation des droits » en matière de prestations et d’imposition, c’est-à-dire un accès aux droits individuels, reposant sur la situation de chaque personne et non en référence à sa famille.

Femmes et pouvoir : le couple impossible ?
Un entretien avec Éliane Viennot sur le site 'Révolution féministe" (5 février 2023)
Éliane Viennot est professeuse émérite de littérature française de la Renaissance à l’université Jean-Monnet-Saint-Étienne et historienne. Elle est notamment l’autrice de « Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin », « L’Académie contre la langue française », « Et la modernité fut masculine », « La France, les femmes et le pouvoir », « Marguerite de Valois », « La différence des sexes » (avec N. Mathevon), « L’engagement des hommes pour l’égalité des sexes » (avec F. Rochefort), « Revisiter la querelle des femmes » (avec N. Pellegrin), « L’âge d’or de l’ordre masculin ».
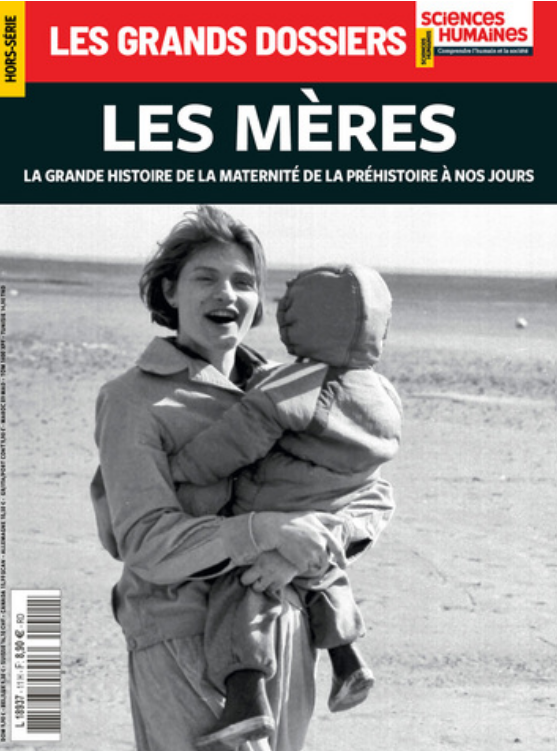
Les Mères - La grande histoire de la maternité
Un numéro spécial du magazine SCIENCES HUMAINES - N° 11 - décembre 2022-janvier 2023
Durant la préhistoire, les femmes accouchaient généralement seules, en position accroupie ou à même le sol, près d’une source ou d’une forêt afin d’accroître le pouvoir vital de la terre ! À plusieurs milliers d’années de là, les mamans du second millénaire mettent leurs bébés au monde dans des univers ultramédicalisés et peuvent recourir à des procréations médicalement assistées.
Une équipe d’historiens et d’historiennes, sociologues, psychologues, anthropologues et philosophes se penche ici sur les grandes questions soulevées par la naissance et la maternité.
Dans toutes les sociétés, le bébé est attendu avec impatience, les débats actuels ne le confirment pourtant pas toujours, et le désir d’enfant reste une énigme irrésolue… Qui pourrait nier cependant que la maternité constitue un des fondements de la vie sociale ? Car ce sont bien dans la majorité des cas les femmes qui enfantent et fabriquent les adultes de demain !

Viol et justice : des victimes présumées consentantes
Un entretien avec Catherine Le Magueresse à l'occasion de la sortie de son livre « Les pièges du consentement, pour une redéfinition pénale du consentement sexuel »
Catherine Le Magueresse est docteure en droit, chercheuse associée à l’Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne et a été présidente de l’AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail) de 1998 à 2008. Elle élabore au fil de ses publications une critique féministe du droit pénal et a notamment publié « Les pièges du consentement, pour une redéfinition pénale du consentement sexuel »
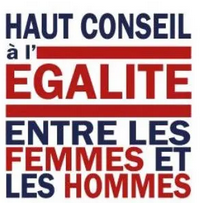
Sexisme : voici les chiffres clés qui témoignent d’une situation alarmante en France
Banalisation du sexisme, violences sexuelles, efforts insuffisants de la part des pouvoirs publics, affirmation d’une sphère masculiniste et antiféministe… Voici les chiffres clés du « Baromètre Sexisme 2023 », publiés ce lundi par le Haut Conseil à l’Égalité.
- Un résumé dans Ouest France (23/01/2023)
- L'intégralité du rapport

Féminismes en revue
Le projet « Féminismes en revue » (FemEnRev) vise à mettre sur pied une plateforme de recherche collaborative pour la numérisation, la structuration, l’enrichissement de métadonnées, l’annotation sémantique, la conservation et la diffusion de corpus de 19 périodiques féministes du second XXème siècle (1944-2019). Les objectifs poursuivis sont doubles, à la confluence d’une exigence patrimoniale et d’une demande scientifique. D’une façon générale, les archives de femmes et féministes souffrent de lacunes et de difficultés de conservation, d’archivage et de diffusion. Ce projet ambitionne de mettre à la disposition d’un large public des ressources périodiques concernant les mouvements féministes, adossées à des outils de traitement documentaire adaptés aux singularités de ces sources. Une attention est portée aux unités de segmentation pertinentes, au traitement des illustrations ou encore au travail sur les métadonnées autrices/auteurs. Ce programme vise également à nourrir les travaux scientifiques en études féministes en France et en Europe et à permettre le développement des recherches sur les revues féministes du XXème siècle en tant que dispositif d’expression et d’action privilégié. Dans une perspective de sociologie du travail féministe, ce corpus alimente les études sur les contextes et les modes de production des périodiques (les institutions, l’organisation des tâches, le degré de professionnalisation des savoir-faire, le financement, etc.). Un axe de recherche s’organise également autour de la question de la diffusion de ces objets, de leur réception et de leurs usages spécifiques par les lectrices. ..
- Explorez en accès libre la perséide FemEnRev (Féminismes En Revue) et découvrez les textes et les oeuvres de centaines de femmes décidées à reprendre le pouvoir littéraire, artistique et politique de nommer le monde pour que surgissent de nouvelles féminités… libres !
https://femenrev.persee.fr

Feminicide : crime passionnel ou crime possessionnel ?
Interview de Patricia Mercader par Francine Sporenda (parue sur le site ENTRELESLIGN ESENTRELESMOTS)
Patricia Mercader, professeure honoraire de psychosociologie, a enseigné de 1994 à 2017 la psychologie sociale à l’université Lumière-Lyon 2, où elle a fait partie du Centre Lyonnais d’Études Féministes et du Centre Louise Labé, et a fonctionné comme chargée de mission à l’égalité femmes-hommes de 2009 à 2017. Avec Annik Houel et Helga Sobota, elle a publié en 2003 « Crime passionnel, crime ordinaire » (PUF) et en 2008 « Psychosociologie du crime passionnel, à la vie à la mort » (PUF).

«Le patriarcat est l’illustration suprême d’un certain mal-être masculin»
Un entretien paru sur le site 50/50, le 2 janvier 2023
Fatoumata Kane Ki-Zerbo, la fille du Sahel, n’est pas une femme comme les autres. C’est une infatigable touche-à-tout d’une infinie sagesse. Militante engagée, elle rêve d’un monde meilleur pour que chacun mais surtout chacune trouve sa place dans nos sociétés et vive dans la dignité. Elle se bat au quotidien pour que les filles d’Afrique aient un autre avenir à travers son métier mais aussi via sa plume.
Fatoumata Kane Ki-Zerbo, vous êtes praticienne en psychothérapie et diplômée en économie et en communication. Vous connaissez bien le continent africain. Voyez vous une différence de la condition des femmes entre le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso, pays où vous avez vécu ? Je crois que vous avez vécu aussi en Guinée…
Je suis venue, sur le tard, il y a dix ans, à la relation d’aide comme praticienne en psychothérapie, un parcours exaltant entre Nice et Montréal où j’ai effectué ma formation et mes stages pratiques, en reconversion professionnelle après avoir travaillé comme organisatrice bancaire puis auditrice dans une banque internationale. J’ai eu la chance de vivre dans de nombreux pays d’Afrique, dont le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, l’Algérie, le Congo, le Gabon, la Guinée, le Zimbabwe et l’Éthiopie. J’ai visité beaucoup d’autres pays du continent et en dehors. Il me semble que la condition des femmes est ...

En Iran, « les femmes sont à l’avant-garde du mouvement social »
Entretien réalisé le 22 novembre 2022 avec Sahar Salahshoor, cinéaste iranienne, co-autrice du programme de « Femmes d’Iran, devant et derrière la caméra », en 2021 pour le mois du film documentaire.

#MeToo est parvenu à toucher tous les milieux sociaux
Un entretien avec Maud Navarre, sociologue spécialiste du genre et du féminisme. Dans CFDT-Magazine n°489-janvier 2023
Dans #MeToo, Maud Navarre voit un mouvement qui a permis une prise de conscience collective de la diversité des réalités vécues par les femmes. Cinq ans après, elle dresse un premier bilan de cette mobilisation d'ampleur.

La décolonisation de l'humanité femelle, une question de survie
A l'occasion de la parution du tome 6 de son "MANIFESTE POUR LA DÉCOLONISATION DE L'HUMANITÉ FEMELLE", une interview de Nicole Roelens par Francine Sporenda, sur le site revolutionfeministe.wordpress.com (4/12/2022)
Nicole Roelens est psychologue clinicienne du travail de formation, analyse la colonisation des femmes dans plusieurs livres, dont le dernier ,« La démarche autogérée de décolonisation », vient de paraître aux éditions L’Harmattan.
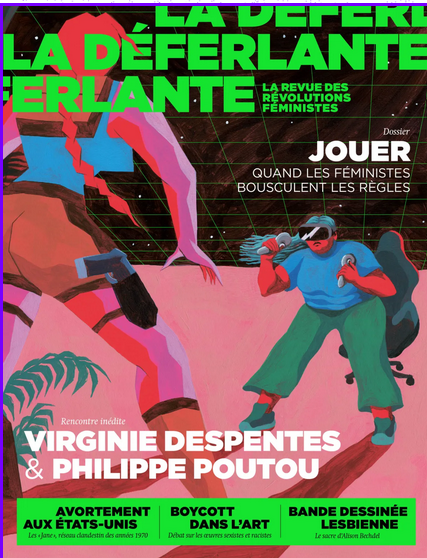
« Le féminisme iranien est une force de contestation révolutionnaire »
Entretien réalisé par Anne Roy, journaliste et membre du comité éditorial de La Déferlante
Un mois après le début du soulèvement en Iran, les manifestations de femmes contre le port du voile se sont transformées en un large mouvement de contestation sociale qui ne semble pas faiblir. Un cas d’école de convergence des luttes qu’analyse pour La Déferlante l’anthropologue franco-iranienne Chowra Makaremi....

« L’effacement des femmes dans tous les domaines est une volonté des hommes de lettres »
Un entretien avec Florence Rochefort et Eliane Viennot sur le site 50/50, le 13/10/2022
Florence Rochefort, historienne et essayiste, co-autrice de Ne nous libérez pas, on s’en charge ! et Eliane Viennot, professeuse, historienne, autrice de nombreux essais dont, En finir avec l’Homme et Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, étaient les invitées des Pages de l’Egalité, un rendez-vous littéraire organisé par la Laboratoire de l’Egalité. L’effacement des femmes dans l’histoire était le thème de cette rencontre. ...

« Renvoyer les violences sexuelles à la seule sphère judiciaire est hypocrite »
Une interview Geneviève Fraisse parue sur le site Entre les lignes Entre les mots le 4 octobre 2022
"Pour la philosophe, spécialiste de la pensée féministe, la question des violences faites aux femmes, au cœur des affaires Quatennens mais aussi Darmanin, est bien plus qu’une histoire de justice. C’est aussi un enjeu politique majeur de nos démocraties que tous les hommes devraient entendre.
Une gifle donnée à sa femme lors d’une dispute conjugale peut-elle être considérée comme une faute politique ? Cinq ans après MeToo, les partis politiques éprouvent de grandes difficultés à gérer les accusations de violences sexuelles et sexistes. Sur quels critères traiter les affaires Adrien Quatennens et Julien Bayou ? Les accusations de violence ou de harcèlement portées dans le domaine privé relèvent-elles du politique ? Comment assurer la présomption d’innocence ? Seule la justice peut répondre, a jugé la philosophe Elisabeth Badinter, interrogée mercredi dans la Matinale de France-Inter. « On livre des hommes à la vindicte publique sans passer par un minimum de justice. » Dans le viseur de l’intellectuelle féministe universaliste, une autre féministe, intersectionnelle post-MeToo...."
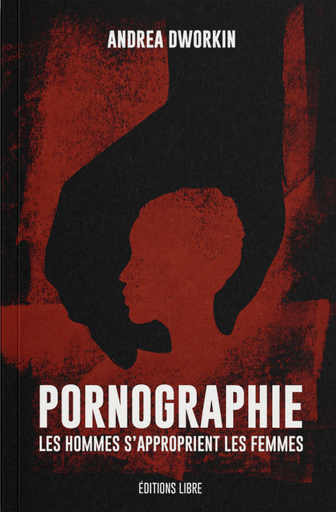
A propos du livre "Pornographie : les hommes s’approprient les femmes (Andrea Dworkin)"
Avant propos par Dora Moutou. Texte paru sur le blog ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS le 2 août 2022
"S’il y a une féministe que j’aurais vraiment aimé rencontrer,
c’est bien Andrea Dworkin.
Elle fait partie des femmes que j’admire, car elle a su parler de sexualité de façon novatrice, critique et incisive.
Mais je n’ai pas eu cette chance. J’avais 18 ans quand elle est décédée et à cette époque, je n’avais pas encore de conscience féministe.
Pourtant à 18 ans, je consommais déjà du porno sur internet, je pensais naïvement que c’était « cool » et même « progressiste ». Pendant de longues années, l’industrie porno a conditionné mes fantasmes et ma vie sexuelle, comme celles de tant de femmes et d’hommes, sans que je sois capable de percevoir les scripts .."
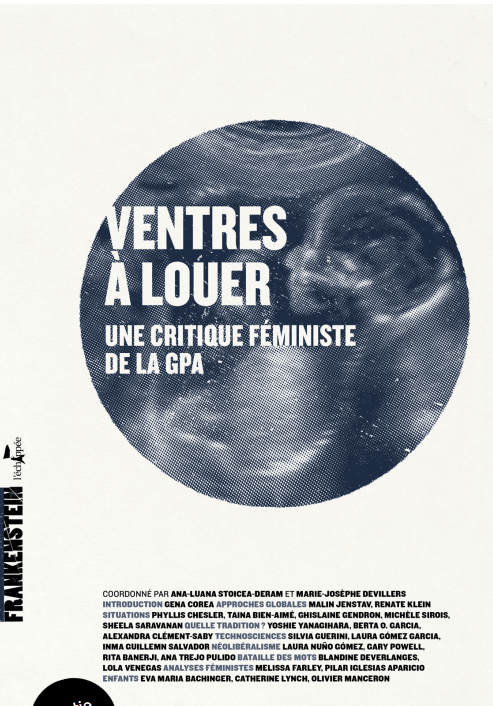
Une critique féministe de la GPA
A propos du livre "Ventres à louer, une critique féministe de la GPA", éditions L’échappée. Livre coordonné par Ana-Luana Stoica-Deram et Marie-Josèphe Devillers [article paru le 31/05/2022 sur le site ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS]
« J’ai grandi. Je me regarde dans la glace du salon. J’ai froid. Je ne sais plus comment faire pour croire à leurs belles histoires de petites graines, de chèvre et de chou, d’amour et d’argent, de silence et d’or, leurs histoires d’enfant qui pousse dans les cœurs et qui grandit comme ça, comme une fleur dans un pot, à la fenêtre d’une cuisine. Un jour j’ai regardé ces deux vieux qui s’aigrissent, mes papas GPA, ces deux gris qui ne veulent pas voir qu’ils vieillissent. Je les ai vus comme ceux qui m’ont acheté au marché, comme un bout de vie, un bout de viande, un bras de mère. » (Olivier Manceron, page 296)
Ventres à louer, une critique féministe de la GPA, édité aux éditions L’échappée, est un essai coordonné par Ana-Luana Stoica-Deram et Marie-Josèphe Devillers. Ce sont vingt-quatre autrices de différents pays et de différentes disciplines qui partagent leurs analyses sur la reproduction artificielle et démontrent, sans aucune ambiguïté, pourquoi ces nouvelles techniques de procréation sont inhumaines et doivent être abolies. ..."

Ne décriez pas le féminisme radical – il a toujours été en avance sur son temps
Un article de Finn Mackay paru le 23 févier 2022 sur le site "tradfem.wordpress.com"
Le féminisme est souvent dépeint comme un dinosaure agonisant sur la voie du progrès. Les jeunes d’aujourd’hui comprennent beaucoup mieux les notions de sexe, de genre et de sexualité. Plus que jamais, il existe une multitude de termes pour décrire les catégories d’identité (Facebook propose plus de 50 choix différents pour le seul genre). En effet, une étude a révélé que les élèves des écoles secondaires britanniques utilisent plus de 23 appellations différentes pour désigner leur identité sexuelle. Dans ce climat, le féminisme, un mouvement construit à partir des expériences d’une identité précise, est considéré comme rétrograde, englué dans le passé. À cela s’ajoutent les idées fausses selon lesquelles le féminisme radical, en particulier, est foncièrement transphobe ; l’étiquette de « Terf », ou féministe radicale trans-excluante, est utilisée envers toute personne exprimant des opinions trans-excluantes, indépendamment de sa politique ou sans même chercher à savoir si elle est vraiment féministe....
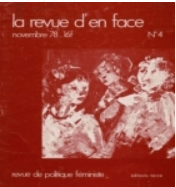
La Revue d'en face
Des militantes ayant créé cette revue féministe en 1977 ont eu la très bonne idée de mettre en ligne l'intégralité des articles publiés à l'époque.
Extraits de la présentation de l'histoire de la revue :
"... Ainsi de 1977 à 1983, à travers 13 numéros (dont un double), la revue d’en face révèle une évolution du féminisme, du militantisme à la recherche, de la contestation au réformisme et à l’institutionnalisation. Le collectif de rédaction a été renouvelé progressivement mais il a conservé ce qui faisait son originalité et son intérêt : la liberté de pensée, la volonté de prendre du recul et d’examiner la réalité sans dogmatisme, le goût pour le débat et la confrontation des points de vue. Il est resté ce lieu de discussions où chacune pouvait avancer son point de vue sans craindre les anathèmes, structurer sa pensée, tester son argumentation avant de la livrer à un public pas toujours aussi bienveillant. Plusieurs y ont acquis l’assurance indispensable à la carrière scientifique ou littéraire qu’elles vont construire ; pour elles, la revue a aussi constitué un tremplin. Quelle que soit l’importance des changements constatés dans la revue, on peut observer une certaine continuité dans la démarche et le positionnement des membres du collectif de rédaction. Ce qui explique que fondatrices des premiers numéros et dernières venues ont pu se retrouver autour du projet de numérisation, avec la volonté commune de transmettre l’expérience qui a tant compté dans leur itinéraire personnel.
.....
Le projet de la revue se donne à lire par le choix de ses rubriques. Une part d’entre elles, « Images », « L’amour toujours », « Moi et ma fille », sont dédiées à l’expression de l’expérience personnelle. Le personnel est politique ! Si la visée est bien de projeter de nouveaux rapports entre les sexes, en débusquant et réduisant les formes d’aliénation, elle passe par l’expression sans fard des contradictions de l’expérience vécue. Avec « Terre des femmes », « En mouvement », Il s’agit d’enquêter, de rendre compte des luttes des femmes, des réalités et des initiatives, ici et ailleurs car la dimension internationale est un fait majeur. L’attention est portée également sur la diffusion du féminisme dans l’ensemble de la société, dans les syndicats, les partis de gauche, notre famille élargie, malgré tout. Evitant toute idéalisation, les enquêtes comme les entretiens restent attentifs à rendre compte des formulations diverses du combat féministe. Avec « En question », « Et alors créa la femme », « Théoraime », l’histoire de l’oppression des femmes offre des mises en perspective, l’analyse des représentations dominantes pose des jalons théoriques et il s’agit aussi de prendre part aux débats, initiés au sein du Mouvement. ..."
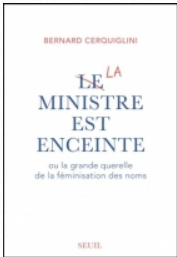
(Le) La Ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms
Un livre de Bernard Cerquiglini
La querelle de la féminisation des noms de métiers (titres, grades, fonctions…) est exemplaire du rôle de la langue dans notre pays. En dix ans, elle a rythmé un des changements les plus rapides et les plus étendus de son histoire. Mêlant, tout comme l’interminable débat orthographique, le linguistique et le politique, opposant les conservateurs et les interventionnistes, confrontant le patrimonial et le fonctionnel, elle fait du français une langue querelle. La récente controverse sur l’écriture inclusive l’a montré à nouveau.
Rien n’est plus passionnant que les aventures de notre langue si on sait nous les raconter. Et c’est bien le talent de Bernard Cerquiglini, qui a su, au fil de ses livres, allier l’humour à la science du français tel qu’on le parle. Il retrace ici l’histoire savoureuse de cette féminisation, les arguments de ses acteurs, leurs hauteurs de vue et parfois leurs petitesses...
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, universitaire. Il a exercé de nombreuses fonctions au ministère de l'Éducation nationale, au Conseil supérieur de la langue française. Il présente l'émission quotidienne de format court Merci professeur! sur TV5 Monde et est l’auteur de nombreux ouvrages.
- La fiche du livre (Editeur)

En finir avec le « masculin générique » et autres fariboles du « masculin valant neutre »
Une recension, parue le 22/12/2021 sur le site ENTRE LES LIGNES ENTRE LES MOTS, du livre d'Eliane Viennot "En finir avec l'homme - Chronique d'une imposture"
"Dans un premier chapitre, Un pays prisonnier de ses mythes, Eliane Viennot aborde le préambule de la Constitution de la IVe République, la Déclaration des droits de 1789, les choix d’une écriture particulière pour désigner des personnes humaines ou des êtres humains. « En 1946, autrement dit, homme ne signifie pas femme aussi. Et Homme pas davantage, d’autant que l’idée de la majuscule n’a pas encore germé ».
Universal Declaration of Human Rights et non droits de l’homme dans sa version francophone.
D’une république à une autre, l’autrice nous parle de l’effacement délibérée de « toute trace de la terminologie innovante » par les juristes autour de Charles De Gaulle, de la disparition des femmes, d’un texte « entièrement conduit au masculin ».
Dans cet ouvrage érudit, mais écrit en langue commune, Eliane Viennot discute des croyances acquises, des adeptes de la domination masculine, d’histoire et d’étymologie de mots, du terme homme et de son impossibilité à désigner l’ensemble des êtres humains, ..."

"Une pièce de plus dans la machine à taire "
Une tribune, parue dans Le Monde du 08/12/2021 : Un collectif de femmes s’étant déclarées publiquement victimes de violences sexuelles de la part de l’ancien ministre Nicolas Hulot et du journaliste PPDA reviennent sur les déclarations récentes du chef de l’Etat, qui a salué la libération de la parole tout en s’inquiétant du risque d’une « société de l’inquisition ».
« Quel est le rapport entre nos récits et l’Inquisition ? De nos intimités exposées naîtrait le risque de replonger la France dans une des périodes les plus sombres et les plus unanimement détestées de l’histoire occidentale ? L’Inquisition a emprisonné, torturé, supplicié, brûlé les hérétiques, ceux qui étaient soupçonnés de mettre en cause la toute-puissance divine et l’institution de l’Eglise. Le souvenir de ses juges ordonnant des traitements cruels pour des culpabilités inventées est resté comme le symbole de l’obscurantisme, de la terreur et de l’arbitraire.
Vous nous mettez du côté des inquisiteurs, figures honnies de la mémoire collective, représentants des pires atrocités du passé. Nos récits porteraient en germe ces tribunaux de l’horreur et de l’injustice. Raconter nos histoires tristes serait nuisible au point qu’il vous faut affirmer votre volonté d’éviter ce très grave danger. Nous sommes des menteuses selon nos agresseurs, une menace pour le pays selon vous. De quel changement néfaste nos paroles seraient-elles les prémices ? Quel pouvoir avons-nous ? Pas celui de condamner, pas celui de priver de liberté. Nous ne sommes ni juges, ni puissantes, ni riches.
Nous avons dit nos hontes les plus intimes, exposé nos larmes ravalées, expliqué nos silences imposés ou nos récits négligés. Ces témoignages ont été, pour beaucoup d’entre nous, difficiles et coûteux. Il nous a fallu des années pour avoir la force de les livrer. Nous l’avons fait pour soutenir les premières, celles qui avaient eu le courage de s’adresser à la justice. Par deux fois, l’institution judiciaire a classé les plaintes et ignoré nos témoignages sans chercher à savoir si d’autres femmes avaient pu être victimes des mêmes hommes.
Nous avons parlé par devoir citoyen. Nous n’avons rien d’autre à y gagner que de dire une vérité, même dérangeante, et d’éclairer le pays sur le traitement des violences sexuelles, sur l’usage que font certains hommes de leur pouvoir, sur les complaisances qui les y autorisent, sur l’impunité dont ils jouissent. Nous l’avons fait dans le respect des institutions et des règles de la République.
Nous avons dévoilé nos noms et nos visages. Certains nous soupçonnent de vouloir faire parler de nous, de nous régaler d’un statut victimaire, de contribuer à l’injustice par le biais d’un imaginaire tribunal médiatique ne respectant aucune règle, de bafouer la présomption d’innocence. On nous dit ce qu’on dit toujours aux femmes : on exagère et on cherche à nuire.
En agitant la menace inquisitoriale, vous en rajoutez une couche, vous nous dites que nous sommes dangereuses. Une pièce de plus dans la machine à taire. Mettre nos misères en lumière risquerait d’enfoncer la France dans les ténèbres ? Nos récits ne devraient-ils pas faire avancer le droit plutôt que de le faire reculer jusqu’aux horreurs de l’Inquisition
Nous ne voulons pas, non plus, d’une société où les victimes de la violence des dominants seraient tenues au silence et condamnées à l’opprobre, à l’infamie et à la caricature si elles transgressent cette règle. Nous ne sommes pas les bourreaux, monsieur le président de la République. Pourquoi faisons-nous si peur ? »

Les 15 essais féministes qu’il faut avoir lus en 2021
Proposition de la revue LES INROCKUPTIBES (01/12/2021)
Culture du viol, invisibilisation des femmes, déconstruction des relations hétérosexuelles… Voici notre sélection des essais féministes qui ont marqué l’année.
L’année 2021 a été riche en essais féministes importants… et on ne va pas s’en plaindre. Abécédaires, livres incarnés, manuels d’action ou encore analyses documentées et a fortiori implacables : qu’ils traitent de la question du genre, de l’amour hétérosexuel, de la culture du viol ou de l’invisibilisation des femmes, tous ont ouvert de nouvelles perspectives de réflexion et ont participé à foutre le feu au patriarcat.
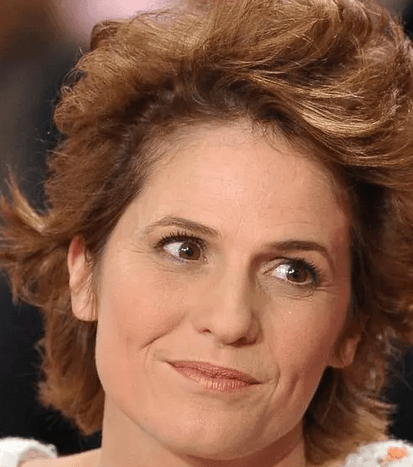
"Il m'a sauté dessus et a tenté de m'embrasser"
L'animatrice Maureen Dor affirme avoir été agressée sexuellement par Nicolas Hulot (sur FRANCE INFO, le 25/11/2021)
Dans un courrier transmis à "Envoyé spécial", Maureen Dor raconte avoir été agressée sexuellement par Nicolas Hulot, dans un hôtel de Bruxelles, en 1989. L'animatrice et comédienne belge avait alors 18 ans..

«Ils me traitent de menteuse, se vantent d’être les meilleurs enquêteurs»
Le 25 novembre est la Journée internationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes. A 19 ans, Jeanne a été violée. Voilà comment elle a été reçue au commissariat. (LE NOUVEL OBS, le 25/11/2021)
Jeanne nous a écrit pour nous raconter la façon dont son dépôt de plainte pour viol s’est déroulé. C’est un texte d’une grande limpidité. Avec le recul des années (les faits se sont produits il y a seize ans), la jeune femme parvient aussi bien à mettre des mots sur l’état psychique dans lequel elle s’est trouvée après son agression, qu’à analyser les dysfonctionnements policiers auxquels elle a fait face.
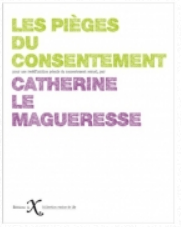
Briser l’infamant carcan de la présomption de consentement qui pèse sur les victimes
Une recension du livre de Catherine Le Magueresse "Les pièges du consentement"
« Dans ce livre, j’emploie le mot victime pour désigner la personne qui a dénoncé les faits, qu’elle ait, ou non, été reconnue par la justice, et agresseurs, violeurs, mis en cause pour désigner l’infracteur nommé par la victime, qu’il ait, ou non, été condamné par la justice ».
« Qu’ont en commun une enfant de onze ans, une femmes de ménage travaillant dans un grand hôtel new-yorkais, une jeune femme ayant participé à une fête populaire dans une ville espagnole, et deux femmes ayant sollicité de l’aide, l’une pour obtenir un logement, l’autre pour effacer une condamnation sur un casier judiciaire ? Elles ont toutes dénoncé des violences sexuelles ». En introduction, Catherine Le Magueresse revient sur des « affaires » où les interactions sexuelles n’étaient pas contestées mais où les hommes arguent d’avoir cru au consentement des femmes, « le consentement est quasi systématiquement invoqué par les agresseurs pour effacer les violences sexuelles et les métamorphoser en simples relations sexuelles ». Le consentement ainsi utilisé devient un piège pour celles qui osent dénoncer les agresseurs.... ».

« Le neutre ne propose pas une nouvelle identité mais invite à se défaire du besoin de fixer une identité de genre »
Un article dans DIACRITIK, le 22 novembre 2021, à propos du livre de Lila Braunschweig "Neutriser : émancipation(s) par le neutre"
A l’heure où le pronom neutre « iel » entre avec fracas dans Le Robert, c’est à une réflexion importante, neuve et profondément originale qu’invite dans Lila Braunschweig dans son essai, Neutriser : emancipation(s) par le neutre qui vient de paraître dans la remarquable collection « Trans » aux Liens qui libèrent. Fondant son propos depuis Blanchot et Barthes, Braunschweig offre, par le neutre, un verbe nouveau qui, à son tour, pourrait entrer dans les dictionnaires : neutriser, verbe qui cherche à suspendre toutes les assignations identitaires, défaire la tyrannie sociale de la binarité et proposer le neutre comme voie émancipatrice. Le neutre n’y est pas une théorie molle : il est une proposition d’action pour métamorphoser le réel, lutter contre ce qui identifie sans retour. Au moment où Brigitte Macron ou Jean-Michel Blanquer attaquent « iel », Diacritik ne pouvait manquer de donner la parole le temps d’un grand entretien à Lila Braunschweig sur ce neutre qui peut tout changer. ...

FIN DE L’IMPUNITE POUR LES PREDATEURS SEXUELS ?
L'interview de Thérèse Lamartine par Francine Sporenda (26 septembre 2021)
Thérése Lamartine a une formation de journaliste et une maîtrise en cinéma. Fondatrice de la Librairie des femmes au Québec, ancienne directrice de Condition féminine Canada, elle est l’autrice de plusieurs livres, dont Une planète en mal d’oestrogènes, femmes et hommes du 21ème siècle, et de Justice sera-t-elle enfin rendue, Weinstein, Matzneff, Rozon et les autres, parus chez M éditeur.
"FS : Après #MeToo, peut-on dire, sur la base des faits observables, que ce mouvement a réellement affecté la façon dont la société et la justice traitent les coupables de crimes sexuels ? Est-ce que la situation matérielle et professionnelle de ces criminels a été réellement impactée par ce mouvement ?
TL : Il y a d’abord eu l’Acte un du grand chamboulement mondial #MoiAussi[1] qui a atteint au moins 85 pays. Puis, la pandémie s’est mise de la partie. Pendant les six premiers mois, j’ai craint qu’elle n’emporte dans son sillage funeste le mouvement. Eh non! Aujourd’hui, force est de constater que, au contraire, le mouvement a pris son rythme de croisière, si l’on peut dire ainsi...."

« En histoire, on a postulé que les femmes n’avaient rien fait »
Un entretien avec Titou Lecoq dans OUEST FRANCE du 22/09/2021
"L’histoire se raconte-t-elle encore avec un grand H comme homme ? C’est l’hypothèse que défend Titiou Lecoq dans son nouvel ouvrage « Les grandes oubliées ». L’autrice détaille comment les femmes ont été écartées du récit de notre passé.
Avez-vous déjà entendu parler de la reine Brunehaut ? De la peintre Artemisia Gentileschi ou encore de la dramaturge Catherine Bernard ? Il est fort possible que non, car ces femmes aux destinées et aux talents hors du commun n’apparaissent pas dans les manuels d’histoire. S’agit-il d’un oubli ou d’une mise à l’écart délibérée des femmes du récit de notre passé ? L’autrice féministe Titiou Lecoq a parcouru les travaux d’historiennes sur la place des femmes dans l’histoire et en livre une synthèse percutant dans son ouvrage « Les grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes » ..."
- L'intégralité de l'entretien (lire et vidéo)
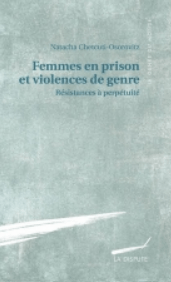
18 mois d’enquête auprès de femmes détenues
Entretien entre Samah Dellai et Natacha Chetcuti-Osorovitz [ sociologue, enseignante-chercheuse à CentraleSupélec, Maîtresse de conférence HDR et chercheuse au Laboratoire institutions et dynamiques de l’économie et de la société de l’École Normale Supérieure Paris-Saclay].
Natacha Chetcuti-Osorovitz vient de publier aux éditions La Dispute (mai 2021) un livre intitulé Femmes en prison et violences de genre. Résistances à perpétuité. S’appuyant sur les récits de femmes incarcérées, l’auteure retrace leurs itinéraires marqués par la violence de genre subie en amont de leur passage à l’acte et de leur condamnation.
- Lire l'article de la revue Contre Temps (n°50 - 2021 - reproduit par le site ENTRELESLIGNESSENTRELESMOTS)
- Pour acheter le numéro de la revue
A propos de l'écriture inclusive : deux opinions
"Écriture inclusive : la guerre des sexes n’aura pas lieu" sur le site LACTUALITE.com
L’écriture inclusive, c’est beaucoup plus que l’utilisation du point médian. Elle vise à ramener le bon sens dans la langue française.
Il y a cinq ans encore, l’idée même qu’on puisse parler d’une femme auteure comme d’une « autrice » faisait rire. Je pense donc qu’il faut se réjouir du débat actuel pour déterminer s’il faut dire auteure ou autrice.
C’est réjouissant parce que cela suppose que presque tout le monde accepte désormais que l’on puisse jouer avec le genre des mots. C’est ce que l’on appelle la féminisation ou l’écriture inclusive. C’est une bataille que les Québécois ont menée il y a 40 ans et qu’ils ont gagnée.
Il était d’ailleurs urgent que les Français se mettent à la page sur cette question, car cela devenait gênant, à la fin. Dans une langue qui est la plus largement enseignée dans le monde après l’anglais et qui demeure très influente, la résistance française faisait tache et déteignait forcément sur la réputation de tous les plus francophones. Mais on sent depuis l’automne dernier que l’Académie française se réconcilie avec son époque et plus largement avec la science linguistique, avec laquelle elle était en chicane depuis un siècle....
- L'intégralité de l'article (Jean-Benoît Nadeau28/01/2020)
"La guerre des sexes : un point, c’est trop ! (Comédie en un acte sur l’écriture inclusive)" sur le site AOC.MEDIA.com
Rarement un seul signe graphique (·) aura fait couler autant d’encre. Rarement aussi le débat public, politique, aura été aussi caricatural, réduisant les rapports complexes qu’entretiennent langue et société à une seule marque (détestable), un seul enjeu (dangereux). Et pendant que le débat fait spectacle, qu’il fait écran, que les politiques de droite et centre droite le récupèrent, la langue, loin des polémiques, dans la vraie vie, doucement, continue d’évoluer....
- L'intégralité de l'article (Julie Neveux 26/05/2021) [la lecture de cet article nécessite une inscription gratuite sur le site]

Comment le pouvoir vint aux hommes
A propos de : Éliane Viennot, L’âge d’or de l’ordre masculin. La France, les femmes et le pouvoir, 1804-1860, CNRS Éditions, un article de Martine Storti , paru le 3 mars dans "LA VIE DES IDEES"
"Éliane Viennot poursuit sa réflexion sur l’histoire des inégalités, des hiérarchies et des disqualifications qui ont frappé les femmes. Organiser légalement leur sujétion ne suffit pas ; il faut aussi la légitimer.
Avec son nouvel ouvrage L’âge d’or de l’ordre masculin, Éliane Viennot poursuit la recherche qu’elle a elle-même nommée « La France, les femmes et le pouvoir », soit une traversée de l’histoire de France à partir du Ve siècle sous un angle précis, celui de la domination masculine, en commençant – ce fut la première étape –, par « L’invention de la loi salique », ouvrage paru en 2006 et qui court du Ve au XVIe siècle...."
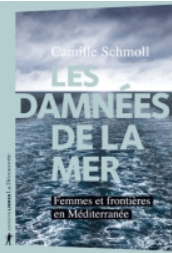
"Franchir la Méditerranée au féminin"
Dans NONFICTION.fr un entretien avec Camille Schmoll, auteure du livre "Les Damnées de la mer"
"Camille Schmoll s'attache à analyser et retranscrire le parcours des femmes qui tentent de franchir la Méditerranée, comblant ainsi les lacunes de nombreuses études sur les migrations.
Camille Schmoll* revient ici, dans le cadre du Thème 3 de Première traitant des frontières, sur le droit de la mer et les frontières maritimes. Toutefois, plus qu’une analyse des frontières et de leur franchissement, elle s’intéresse à ceux et surtout à celles qui se lancent dans la traversée de la Méditerranée. Son récent ouvrage livre une analyse percutante des femmes qui pratiquent ce franchissement depuis l’Afrique vers l’Europe dans le cadre d'une « crise migratoire » qu'il convient de remettre en question. Ces parcours sont marqués par une violence constante et protéiforme de leur départ à leur arrivée...."

Le féminisme a de l'avenir
Un dossier de la revue BALISES (n°4 janvier/mars 2021) de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou
Présentation :
À quoi sert encore d’être féministe alors que l’égalité entre hommes et femmes est inscrite dans la loi française et dans le droit international ? À cette question, l’écrivaine et journaliste Benoîte Groult répondait : « parce que le féminisme n’a jamais tué personne et que le machisme tue tous les jours ». De fait, harcèlement, viols, féminicides persistent et s’accompagnent encore d’atteintes aux droits fondamentaux des femmes et d’innombrables inégalités.
Mais le féminisme 3.0 riposte en France, aux États-Unis, au Chili ou en Inde. Manifestations, performances, hashtags, vidéos en ligne, podcasts et nouvelles recherches universitaires donnent à la réflexion sur l’émancipation féminine et les questions de genre une profondeur inédite. Ces nouvelles formes de mobilisation offrent aux revendications féministes des outils neufs pour atteindre, enfin, l’égalité réelle entre les genres.
En lien avec le cycle « Le féminisme n’a jamais tué personne » organisé par la Bpi en 2021, Balises donne quelques pistes dans ce dossier pour s’emparer du sujet.

L'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l’invisibilisation des femmes.
Un article paru dans 50/50, le 10/12/2020
Marylène Patou Mathis est préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au département préhistoire du Musée de l’Homme. Son dernier ouvrage L’homme préhistorique est aussi une femme , destiné aussi bien aux expert·es qu’au grand public, couvre une période plus importante que son titre ne le laisse présager, il en est d’autant plus éclairant.
Dans un premier temps l’autrice explique deux mille ans de notre passé misogyne depuis les débuts de la civilisation européenne. Elle met en lumière les assertions des philosophes de l’antiquité, repris par les dogmes de l’Eglise et par les scientifiques qui se sont efforcés de prouver ces dires. Elles permettent de mieux comprendre l’interprétation biaisée de la préhistoire, développée dans un deuxième temps....

« Beaucoup de femmes qui portent le niqab sont aussi dans une démarche très adolescente, de réaction contre l’ordre établi »
Cette interview de Agnès De Feo parue il y a quelques semaines, dix ans après l’adoption de la loi sur l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public (le journal 20 Minutes 11 octobre 2020)
Pendant plus de dix ans, la sociologue Agnès De Feo a rencontré et interrogé des femmes françaises portant le voile intégral.
Cette interview de Agnès De Feo parue il y a quelques semaines, dix ans après l’adoption de la loi sur l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public (le journal 20 Minutes 11 octobre 2020)
Pendant plus de dix ans, la sociologue Agnès De Feo a rencontré et interrogé des femmes françaises portant le voile intégral.