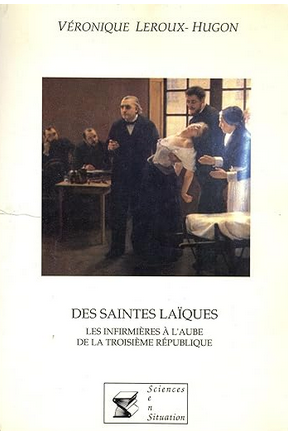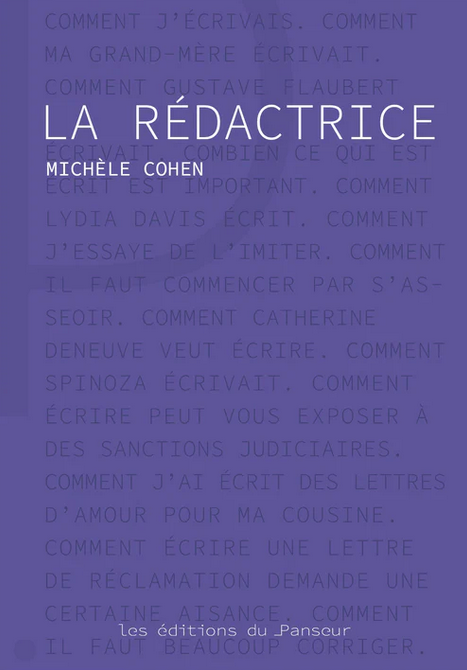Véronique Leroux-Hugon
Conservateure des bibliothèques. Membre de l’APA (Association Pour l’Autobiographie) et du comité de rédaction de la FAR (Faute à Rousseau) . Boulimique de lectures et notamment d’autobiographies .
Quelques écrits :
- "Des saintes laïques - Les infirmières à l'aube de la Troisième République". Edition Sciences en situation. 1992 (Sur la naissance de la profession infirmière).
- Participation à plusieurs ouvrages sur la Bibliothèque Charcot à la Salpêtrière.
- Communications à plusieurs colloques ou numéros de revues sur l'autobiographie, le récit d'enfance, maladie et autobiographie.
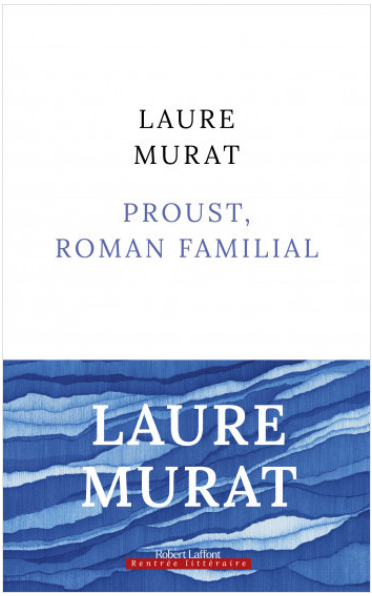
Le déclic de Downton Abbey (21/06/2024)
Une note de lecture à propos du livre de Laure Murat. "Proust, roman familial".
Proust, roman, famille : trois termes chargés pour moi d’affect, tant ce sont les trois pôles magnétiques de mon attirance pour la littérature, tant Laure Murat dans un petit livre d’apparence anodine nous en donne les voies d’accès.
Curieux objet a priori que cette étude : analyse littéraire d’A la recherche du temps perdu parmi des centaines, menée par une professeure aux Etats-Unis qui a enquêté sur Flaubert, Nerval, Maupassant et la librairie d’Adrienne Monnier, ou par ce livre : Relire. Enquête sur une passion littéraire ?
Ou encore biographie de Proust écrite par la descendante d’une généalogie prestigieuse qu’elle renie, tout en démontant de manière magistrale les mécanismes utilisés par Proust pour décrire ce monde d’avant ?
Ou bien autobiographie, réflexion sur l’appartenance au troisième sexe, sur l’aveu et ses conséquences que l’œuvre de Proust permet de décrypter au plus profond. Qui l’aurait pensé ? : c’est en visionnant une série anglaise : Downton Abbey qu’elle ressent le déclic, qui, tel un pavé disjoint dans la cour des Guermantes, lui fait appréhender sa compréhension d’un monde dont (« que je le veuille ou non ») elle fait partie. Elle note alors « Dans cette traversée presqu’inintelligible des couches du temps, je me sens à bien des égards tombée en droite ligne et en chute libre du dix-neuvième siècle. »
L’air de rien, en utilisant des titres à la banalité surprenante, des chapitres courts, Laure Murat nous ouvre alors à la lecture de la Recherche d’un point de vue très personnel, tel un réseau dont elle dessine les configurations multiples.
C’est en enseignant à « L.A. » qu’elle a pu développer la cartographie de la Recherche : une vaste déconstruction de l’aristocratie fin-de-siècle, laquelle abusivement fière de ses racines millénaires, s’acharne à maintenir un monde qui n’est plus. » Laure Murat, désinhibée par son installation aux Etats-Unis, est bien placée pour le savoir. Par le Roman (qui mérite ici une majuscule) Proust, en « petit journaliste » nous donne à voir l’effondrement de cette société, élaborant en phrases magnifiques, une œuvre sans cesse retouchée. Après l’avoir disséqué dans ses moindres détails par des formules sublimes qui touchent au plus profond de l’analyse, l’écrivain prophétise subtilement la disparition de ce monde factice, l’éclatement d’une bulle remplie de rien. Une bibliothèque entière n’a pas suffi à analyser la Recherche mais Laure Murat, sans doute par sa connaissance intrinsèque de ce monde, analyse avec acuité la fascination de Proust pour celui-ci.
Après Proust et sous le couvert d’une analyse littéraire et sociologique, Laure Murat nous fait entrer dans un monde qui n’en cesse pas de mourir, celui de l’aristocratie, un musée, dont, à son corps défendant, elle a fait partie. Elle démonte alors les mécanismes du projet proustien en une sublimation inversée où la forme proustienne donnait du sens à la vacuité de la forme », cette noblesse française, constamment en représentation. Proust se livre à « un exercice continu de dessillement livrant une grille de compréhension et de déchiffrement du monde ». Livre immense, La recherche est comme une Tour de Babel, « un espace intelligent qui invitait à tourner sans fin, entrer, sortir, grimper et redescendre, emprunter tous les escaliers et arpenter tous les couloirs du temps. ». C’est encore, suggère-t-elle un grand œuvre, bâti comme une cathédrale sur les fondements de la perfection rituelle et vide de l’aristocratie.
Cette dernière, à travers Tante Oriane et Oncle Basin n’a rien perçu de la grandeur de Proust, lui-même ambivalent, partagé entre la fascination et le rejet de ce monde englouti, qu’il a mis à nu.
Démêlant l’enchevêtrement des dynasties réelles ou imaginaires : les Murat, les Luynes, les Guermantes, Laure Murat, au milieu de son essai, en vient au troisième sexe, à sa propre homosexualité. Ici autobiographique, le livre décrit la rupture totale d’avec sa famille, dressant un portrait terrifiant, sinon comique de ses parents, celui d’un père, lâche, gêné au plus haut point que cette chose-là touche sa fille et donc la famille. Avec des accents très contemporains, elle évoque sa mère : « sa détestation des gauchistes et des féministes n’était surpassée que par sa haine de l’homosexualité qui confinait à la manie. », mais décrit avec tendresse un père lecteur, annotant les tomes fatigués de la Recherche, qui lui a peut-être donné goût à la littérature. Avec cela, l’opprobre unanime de la famille, et sa loi : l’injonction au silence, l’ont alors, paradoxalement « sortie d’une lugubre gangue comme on se défait d’un manteau d’infamie »
C’est « Proust au bordel » qui « tout en pulvérisant l’aristocratie, installe Sodome et Gomorrhe au cœur de son projet littéraire. ». En analysant la vie nocturne de Paris-Sodome, le silence et l’implicite, il élabore une œuvre où « questions sexuelles et textuelles sont indissociables. » Comme sont indissociables pour Laure Murat la fréquentation, continue, de la Recherche et l’ouverture au réel puisqu’ écrit-elle, « ma lecture … m’a instaurée en tant que sujet en dépliant le sens des mises en scènes attachées à l’homosexualité. En un seul livre ouvrant à l’espace enchanté, multiple et infini du roman…, la Recherche propose… une grille de compréhension et de déchiffrement du monde… : Proust m’a sauvée. »

Michèle Cohen : la Rédactrice
Une note de lecture parue sur le site de l'APA le 1 juin 2023
Du chapitre Ne pas savoir au dernier, Langue de coton, Michèle Cohen tisse ici, sur une trame légère autant qu’élégante, les fils d’une autobiographie, sous couvert de l’évocation d’un métier, celui, apparemment vague, de rédactrice.
Cela commence par des exercices d’écriture, cela continue par des histoires d’origines, de rencontres, de modes d’emploi du type : « Comment j’ai appris à écrire à coups de pied au cul », toujours contés avec humour, mais aussi passion ; passion pour les mille ruses de l’écriture, on devrait dire des écritures, la publicitaire, la poétique, d’autres encore comme celle, désopilante, de la rédaction d’une pub pour le « PQ », ou pour les qualités d’une lessive....

Guerre d’Algérie - Engagements et expériences
Textes choisis et introduits par Véronique Leroux-Hugon
Préface Paquito Schmidt
Contribution de Jade Cazorla
Cahier uniquement en ligne pour le moment. D’où son absence de numérotation et son statut de Cahier hors-série. La publication d’une version papier est envisagée courant 2023.
"... Pour ce nouveau Cahier, j’ai choisi dans les textes, dont certains récemment déposés, des passages beaucoup plus longs, en cherchant à souligner comment, d’une manière ou d’une autre, leurs auteurs s’étaient engagés dans le combat pour l’indépendance : engagement « forcé » des appelés, engagements politiques, engagements dans le quotidien. J’ai souhaité montrer la richesse et la variété des pages qui nous sont confiées, le travail d’écriture autobiographique qu’on y lit, celui des descendants de ces générations, conscients de l’intérêt des cahiers, des feuillets retrouvés." (Véronique Leroux-Hugon)
- Lire ICI
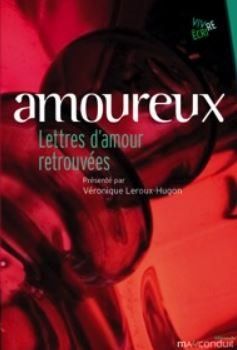
Amoureux - lettres d'amour retrouvées
Livre de Véronique Leroux-Hugon
Dans ce livre sont rassemblées dix correspondances amoureuses inédites, découvertes dans les archives de l’Association pour l’autobiographie et le Patrimoine Autobiographique (APA). Dix échanges amoureux – et savoureux – qui, tout au long du xxe siècle, constituent autant de nouvelles écrites par des gens « ordinaires », avec moult détails sur la vie quotidienne et sur l’époque.
Depuis les lettres envoyées du front par un médecin-major à son épouse pendant la guerre de 14-18 jusqu’aux missives passionnées d’une femme à son amant en 2002, en passant par un étonnant dialogue amoureux soldé par un mariage dans les années 1950, c’est l’éloignement, le plus souvent imposé, qui justifie la rédaction de ces courriers. À commencer par celui dû aux deux conflits mondiaux qui ont engendré l’amplification étonnante des échanges postaux à cette période.
On entre dans l’intimité de couples, brisés par les conflits ou les intermittences du cœur, mais dont la sincérité est toujours de mise. Intense, vraie, déchirante, la lettre d’amour continue de tisser le lien avec l’être aimé absent. Elle lui donne chair par la force de l’imaginaire et de l’écriture
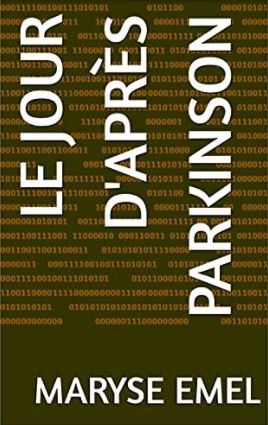
Le jour d’après Parkinson
Recension du livre "Le jour d’après Parkinson" de Maryse Emel
Professeur de philosophie à la Courneuve pendant vingt ans, Maryse Emel doit arrêter son travail à 45 ans, trop éprouvée par la maladie de Parkinson, maladie invalidante, maladie de la honte.
Durant cette soixantaine de pages, elle décrit sa lutte contre la maladie curieusement individualisée, comme il est maintenant d’usage : « J’ai Parkinson ». « J’avance, soucieuse de mes désirs… » termine- t-elle un magnifique prologue pour dire son amour de la philosophie, à l’enseigner d’abord, puis à s’en nourrir par l’écriture : « J’aime le corridor des mots, le déambulatoire de la pensée. Au chemin de Descartes, je préfère la marche qui trace son chemin au risque de la surprise et de l’inquiétude… »
C’est d’une autre marche qu’il est ici question puisque Parkinson l’empêche, détruit progressivement les mécanismes du mouvement, donnant à l’individu, prisonnier d’un corps immaîtrisable, cette allure clownesque, cette explosion incontrôlable de gestes désordonnés. Son corps vit sa propre vie, la détruit, l’isole. Les traitements, ici la dopamine, ne sont pas sans graves troubles secondaires.
Invoquant son enfance, elle note : « Je donne naissance à des souvenirs par des mots. Les mots viendront à mon secours pour forcer Parkinson à rendre des comptes » […] « Ecrire c’est aussi cela, s’absenter des lieux communs à tous pour construire la présence d’un nouveau possible ». De ses souvenirs émerge la figure d’un père violent dont elle a peur, même après un AVC qui le diminue.
A plusieurs reprises, elle évoque aussi la présence d’un petit garçon qui l’a aidée, peut-être par sa vulnérabilité, auquel elle se confie, son double, un petit-fils ?
La maladie, surtout celle-là, c’est la disparition de la fluidité des mouvements, cette rigidité humiliante pour un professeur, qui doit abandonner à regret l’enseignement. Parkinson provoque le confinement, la solitude, la folie qu’engendre un corps tourmenté et difforme au comportement hors-norme.
Plus graves encore sont les désordres psychiques engendrés par « P » : perte de soi, aliénation, dérives : « J’ai connu l’abandon, les nuits blanches, les rencontres improbables ». Une période noire qui la dégoûte mais durant laquelle elle se met à peindre, notamment les falaises de Basse-Normandie et leur érosion, travaillant matériaux et techniques pour traduire ce délabrement : « L’espace de la toile devenait l’empreinte d’un combat difficile et douloureux, perdu d’avance….. mes cauchemars prenaient forme. Je les exposais. Jusqu’au jour où l’écrit prit la suite. »
Dans ce texte déchirant, elle dit encore : « Cette maladie inquiète par les signes qu’elle manifeste. Signe de l’inquiétante étrangeté, elle est la porte qui s’ouvre à la folie. La porte s’ouvre et se ferme. La volonté ne cesse de chercher les clés pour fermer à double tour. Elle craint les courants d’air. »
Et si ces courants d’air, c’étaient les mots, moins ternes qu’elle ne le pense, qui l’aideront, avec la présence du petit enfant, à sortir de l’énigme vitale qui demeure mais qu’il faut admettre ? [décembre 2021]
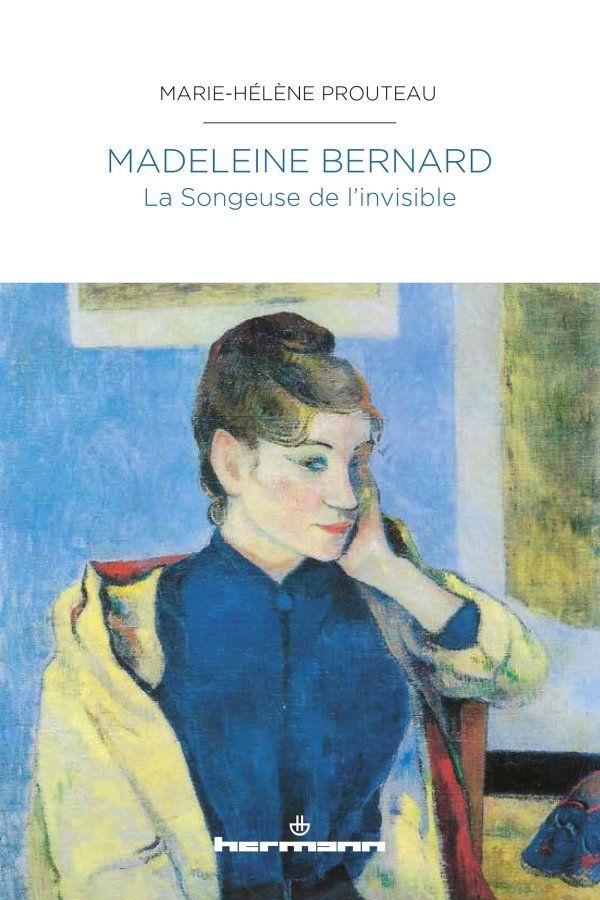
A propos de "Madeleine Bernard-La songeuse de l’invisible" de M.H. Prouteau
Note de lecture (15 avril 2021)
Née en 1871 Madeleine Bernard est la sœur bien aimée du peintre Emile Bernard avec laquelle elle forme quasiment un couple, des « cœurs siamois » navigant dans les milieux de l’art post impressionnisme de Van Gogh à Gauguin, à Odilon Redon et à bien des artistes de la fin dix-neuvième.
Ayant consulté des correspondances à son frère et à la famille Bernard, Marie Hélène Prouteau, après plusieurs livres autobiographiques a entrepris cette biographie romancée, narrée au présent pour tenter de recréer la vie de cette jeune femme d’une grande beauté, morte à 24 ans de la tuberculose.
On sent que la biographe s’est nourrie de cette peinture, de cette attirance des artistes pour la couleur qu’elle sait élégamment rendre dans ses descriptions. On est tenté de feuilleter parallèlement à la lecture un catalogue des Post-impressionistes, ou Synthétistes dont Emile Bernard est la tête de file. Ils peignent, comme Seurat, les bords de Seine, où la famille a déménagé, et la Bretagne découverte avec enthousiasme par Emile.
En regardant le portrait reproduit en couverture, on s’explique le sous- titre : « La songeuse de l’invisible ». Madeleine, assise, la tête inclinée sur la main, le regard mystérieux semble méditer. Dans de superbes nuances de bleu et de jaune, la toile a été exécutée par Gauguin très attiré par cette jeune demoiselle, au temps des rencontres à St Briac ou Pont-Aven. Il lui écrit, par exemple en 1888, où il l’appelle « chère sœur » dans une ambiguïté de rapports significative. Le portrait a été peint au verso d’une toile appelée La rivière blanche, c’est un thème que Marie Hélène Prouteau reprend à plusieurs reprises pour évoquer le cours mélancolique de la vie de Madeleine, telle qu’on se la représente aussi dans Madeleine au Bois d’amour, peint par son frère. La rupture de Gauguin avec Emile qui se considère trahi artistiquement n’en sera que plus douloureuse pour elle.
A partir d’un « duo de cœurs au royaume d’enfance » (p 17) c’est tout autant la vie et l’œuvre de son frère Emile, un « phénomène », qui sont évoquées. Madeleine, fragile, silencieuse est toujours dans l’ombre de ce peintre tourmenté, fâché avec ses parents, qui l’entraine dans sa fascination pour l’art religieux, le mysticisme et les spiritualités orientales. Elle le rejoint en Bretagne à St Briac à plusieurs reprises, rencontre donc ses amis, ce milieu riche en talents picturaux.
Cette même période voit un début d’émancipation féminine : Madeleine en mésentente avec sa mère, se lasse vite des ateliers de couture parisiens où elle s’est embauchée, préfère aux bavardages la poésie de Marceline Desbordes-Valmore, esquisse des fiançailles qui n’aboutiront pas, poursuit une amitié avec Charlotte que sa mère est prompte à dénoncer comme scandaleuse. En 1892 elle va travailler au service d’une famille à Arcachon mais les assiduités du père l’importunent. Elle s’en console en écrivant à Emile une lettre qu’il qualifiera de Chef d’œuvre de philosophie, de religion et d’amour. Madeleine part en Angleterre pour se perfectionner dans un atelier de mode, occasion de nouveaux échanges épistolaires, mais, poursuivie par son persécuteur, s’enfuit avec Charlotte à Genève où elles vont tenir un kioske à journaux. C’est à cette occasion, en soignant son frère Augustin de Moerder qu’elle rencontrera Isabelle Eberhardt à la vie aventureuse. Une vie qui aurait peut- être tenté Madeleine, tant elle est curieuse des nouveaux courants de pensée. La famille d’Augustin refusant tout mariage, Madeleine part au Caire retrouver son frère mais la maladie s’aggrave et elle y meurt en 1895.
Marie Hélène Prouteau n’a exploité que de manière succincte les lettres auxquelles elle a eu accès, et dont elle cite de très courts extraits en début de chapitre, mais elle s’est imprégnée de lectures et a mis à profit sa grande connaissance des tendances artistiques contemporaines pour rendre l’ambiance dans laquelle a vécu brièvement cette jeune femme méconnue.
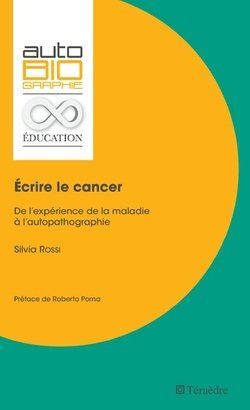
A propos de "Ecrire le cancer" de Silvia Rossi
Note de lecture parue le 8 mai 2020 sur le site de l'APA
"Bénéfice secondaire du confinement : j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres le livre de Silvia Rossi, gentiment déposé par cette voisine … Silvia Rossi était intervenue lors d’une table ronde de l’APA présentant notre Cahier de relecture n°61 : Écrire la maladie en 2016. Son livre publié dans la collection (Auto)biographie & Education dirigée par Christine Delory-Momberger reprend et approfondit le propos.
Le projet de sa thèse, soutenue en 2016, est le suivant : à partir de six textes d’écrivains italiens, analyser le rôle du cancer comme déclencheur d’écriture, matière de la narration. Aussi, elle décrypte systématiquement dans ces ouvrages le recours aux métaphores pour narrer cette expérience vitale, dans une perspective très actuelle de redonner la parole aux patients. De fait, ce sont plutôt les malades (du sida, du cancer ici) qui prennent la parole depuis quelques décennies et font du récit de leur expérience un outil, pour ne pas dire une arme..."
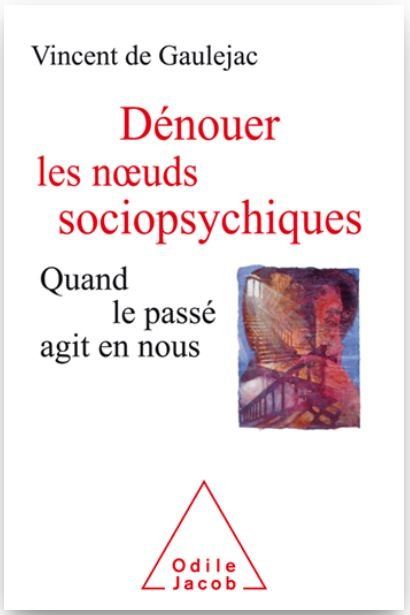
"Dénouer les nœuds sociopsychiques" - recension de Véronique Leroux-Hugon
A propos du livre de Vincent de Gauléjac "Dénouer les nœuds sociopsychiques - Quand le passé agit en nous "
« Devenir historien de soi-même pour dénouer les nœuds socio psychiques de son existence, telle est l’ambition de la clinique de l’historicité. »
Cette formule résume toute l’ambition de ce livre, un bilan ouvert de l’ensemble des recherches que Vincent de Gaulejac mène en équipe depuis la fin du xxe siècle, puisque Névrose de classe est paru en 1987 et a été réédité en 2016. Dans une première partie, il décrit plusieurs expériences, le vécu de la honte dans différentes circonstances professionnelles, historiques, en santé mentale. Il analyse son propre parcours de chercheur, ce qu’implique cette posture, en référence à Georges Devereux et à Jean-Paul Sartre.
La seconde partie, riche en réflexions théoriques, revisitant d’autres perspectives, psychanalytiques, socioéconomiques, tend à montrer en quoi la sociologie clinique, telle qu’il la conçoit, propose une voie différente et prometteuse.
On suivra la démarche de chapitres en chapitres, auxquels l’auteur attribue souvent un titre à double entrée, notamment dans la deuxième partie, intitulée : « L’histoire fait l’homme, les hommes font des histoires. » ou bien « Vivre pour se raconter, se raconter pour vivre ».
C’est bien sûr des histoires de vie qu’il est question ici, dont l’auteur donne plusieurs définitions qui se recoupent, comme celle-ci : « Le récit de vie permet de saisir ces influences réciproques entre les processus de fabrication sociale des individus et les processus par lesquels l’individu cherche à advenir comme créateur de sa propre existence. Le sujet ne peut exister que dans la mesure où il est d’abord assujetti à ses conditions concrètes d’existence, à son origine sociale, à l’histoire de ses ascendants, autant de déterminations qui le constituent jusque dans les profondeurs de son inconscient. »
À quoi il faut ajouter cette remarque de Philippe Lejeune, rapportée par Vincent de Gaulejac : « L’autobiographie se déploie entre deux polarités l’une qui cherche à dire le vrai, l’autre qui donne une version héroïque ».
Proposant une méthode pour explorer, voire dénouer les nœuds psychiques, le livre s’ouvre sur un premier exemple du fonctionnement d’un groupe d’Implication et de recherche (GIR), dispositif lancé dans les années 80 visant à dénouer les nœuds psychiques qui nous entravent, d’exercer cette clinique de l’historicité. Quel en est le concept ? : « Le projet de la sociologie clinique s’inscrit dans une perspective dialectique qui consiste à montrer le bénéfice pour la sociologie de s’intéresser à la subjectivité et pour le clinicien de prendre en compte les conditions sociales qui favorisent ou limitent sa pratique. » Dans ces groupes, dont la méthodologie est détaillée en annexe, l’animateur propose de chercher comment comprendre les destinées humaines à partir du travail du sujet face à l’inconscient, aux déterminismes sociaux, aux choix et aux ruptures de son existence. L’auteur présente ces GIR comme des lieux de mémoire, pour un travail en commun où la remémoration du passé éclaire l’histoire présente de l’individu et de la société.
S’appuyant sur une bibliographie très riche, il reprend les analyses d’Anne Ancelin Schützenberger (Aïe mes aïeux , 1988) sur le poids des générations et des secrets enfouis, pour montrer comment ces pesanteurs s’amalgament pour faire une histoire et comment l’individu peut reprendre cette histoire, s’en désentraver, se construire lui-même, en jouant sur tous les registres de l’existence humaine : le sujet qui parle, le sujet sociohistorique, le sujet désirant, le sujet émotionnel, le sujet acteur. Revenant sur l’historicité il remarque :« L ’individu est fabriqué par l’histoire, ce qu’il en raconte n’est pas la réalité de cette histoire, quand bien même les souvenirs contiennent des éléments de cette réalité, mais une reconstruction du temps passé en fonction des nécessités du présent. »
Traçant la genèse des récits de vie dans un chapitre passionnant (chap. XI), il établit une comparaison entre la psychanalyse freudienne et la démarche sociologique de Pierre Bourdieu, en proposant d’incorporer l’apport des deux disciplines, de les dépasser donc dans cette clinique de l’historicité qu’il préconise.
S’il souligne les différents processus de falsification à l’œuvre dans les récits de vie il note encore que le sujet a besoin de mots, de récits, de traces, de témoignages qui lui donnent à voir, à éprouver à mémoriser l’histoire, à lui conférer une réalité, avec cette formule : « Les hommes sont tiraillés entre le souci de voir les choses comme elles sont et le désir de réenchanter le monde en s’inventant des histoires. »
Sans dissimuler, et nous le savons bien, combien la pratique du récit de soi est controversée, il remarque encore qu’elle se substitue aux grands récits, désenchantés, épopées religieuses, politiques ou scientifiques, dorénavant décalés.
Une chronique est toujours réductrice et ne saurait épuiser toute la richesse de ce livre. Après en avoir multiplié à l’excès les citations, on terminera par cette jolie métaphore : « Dans le rôle de rempailleur d’histoire, le sociologue clinicien propose de revisiter « le vaste palais de la mémoire » pour comprendre les traces du passé toujours actives dans les moments présents.
Il offre un cadre et une méthode pour comprendre comment l’histoire est agissante en soi et, faute d’en modifier le cours, changer son rapport à un passé toujours présent. »

Ma page de lecture
Véronique Leroux-Hugon nous parle de son activité quotidienne : l’enregistrement de livres pour des non-voyants (16 mars 2020)
Comme d’autres font leur gymnastique je me livre à un exercice quotidien dont j’apprécie les bénéfices secondaires : en l’occurrence, il s’agit ici de l’enregistrement de livres pour des non-voyants.
La technique d’enregistrement a été mise au point par la Bibliothèque Sonore de Paris, avec le recours à un logiciel très simple, qui permet à tout moment de corriger, effacer et vérifier le projet en cours. La base de données de ces enregistrements constituée par la BSP représente un fonds considérable de livres dans lequel puiser, permettant des écoutes d’ouvrages dans tous les domaines pour les personnes habilitées à se les procurer. C’est aussi un réservoir dans lequel puiser des suggestions de lectures. Une fois l’enregistrement effectué, il est validé par une équipe attentive à sa cohérence et à sa qualité
C’est de ma pratique personnelle qu’il sera question ici. L’idée m’en est venue après avoir observé une personne proche qui dans les années 70, copiait des livres sur une machine spéciale qui imprimait des caractères en braille sur de longues feuilles de carton en accordéon. J’ai gardé le souvenir de cette besogne fastidieuse, très lente mais qui était alors sans doute inventive et utile.
Revenons au contemporain, à commencer par le choix des livres lus. Toute latitude est laissée au lecteur bénévole pour proposer un titre et ce choix personnel est certes subjectif mais très stimulant. Pour ma part je me régale à l’avance de proposer tel ou tel livre, en établissant avec gourmandise des listes de titres « à enregistrer », basées sur l’intérêt qu’on escompte de cette lecture. Cette entreprise assez longue, soit une moyenne de deux à trois mois par titre enregistré, menée de manière quotidienne, doit demeurer attrayante tout au long du projet, me semble-t-il. Et ce sont bien entendu dans « mes » sujets de prédilection que je puise des idées, à savoir, des romans, des thèmes historiques et sociologiques, et bien sûr des autobiographies. Ce dernier type d’ouvrage se prête particulièrement à l’exercice, puisqu’il suit intrinsèquement une progression chronologique. J’ai quelquefois choisi aussi d’enregistrer des livres (fictions, enquêtes) écrits par des amis, avec l’impression d’évoluer dans une atmosphère plus familière, si j’ose dire, en superposant à ma lecture ce que je savais de l’écrivain en question.
Après avoir veillé à supprimer les bruits extérieurs, fenêtres et portes fermées, installée devant l’écran après quelques manœuvres de mise en train, je m’éclaircis la voix, et plonge dans une atmosphère particulière tandis que défilent les lignes du texte et la bande passante de l’enregistrement avec ses pics surlignés d’un vert phosphorescent : gare au rouge qui signifie saturation et implique arrêt et reprise du travail ! Il faut veiller à la vitesse (les dames enregistrent souvent trop vite, m’a-t-on dit …), éviter la monotonie, les balbutiements, tenter de rendre perceptible ponctuation, points d’exclamation et autres redoutables guillemets. Chaque plage d’enregistrement ne doit pas dépasser dix minutes, suivies de la réécoute immédiate, engendrant corrections ou suppressions et cette amplitude se révèle satisfaisante pour éviter lassitude et/ou bafouillements.
Au-delà de ces considérations techniques, dont on comprend vite l’utilité, le plaisir (et j’emploie volontairement le terme) vient de cette immersion dans un univers de mots, un monde romanesque ou de recherche, une découverte d’autant plus attrayante que je n’ai pas encore lu l’ouvrage choisi suivant mes critères habituels. Découverte donc et qui amène parfois à des déceptions, d’autres fois à la satisfaction d’avoir fait le bon choix, de pouvoir s’approprier l’œuvre en quelque sorte .Mais cette plongée se révèle parfois périlleuse , révélant mon incapacité à entrer dans un style, suivre un récit de facture trop déroutante .J’en donnerai un seul exemple , à propos d’une œuvre qui m’intéressait beaucoup par ailleurs : j’ai dû renoncer à enregistrer Le livre brisé de Serge Doubrovsky, me trouvant dans l’impossibilité de rendre cette écriture inimitable, de longues phrases sans ponctuation, mêlant italiques, majuscules et autres germanismes accolés au français. Echec (?) de la tentative qui souligne combien la subjectivité influence ce type de lecture : c’est un obstacle qu’il faut éviter si agacements, voire désapprobation ou a contrario excès d’enthousiasme se révèlent par trop audibles, incompatibles avec la neutralité nécessaire vis-à-vis d’auditeurs anonymes. Par définition, on ne connaît pas en effet ces auditeurs et a fortiori leurs goûts et leurs possibles réactions.
Pour terminer je voudrai redire l’intérêt de cette expérience, que je considère comme une certaine discipline mais toujours satisfaisante, d’autant plus que cette lecture à voix haute, nécessairement plus lente, favorise une appréhension beaucoup plus fine de l’œuvre choisie.
Mon ambition bien prétentieuse, serait de donner une seconde vie (une autre voix) au livre sélectionné.
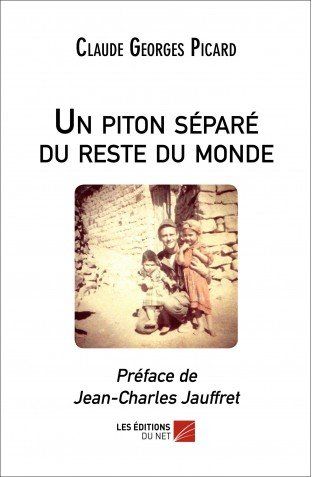
Véronique Leroux-Hugon parle du livre "Un piton séparé du reste du monde"
Note de lecture de Véronique Leroux-Hugon – 09 octobre 2018 à propos du livre "Un piton séparé du reste du monde" (auteur Claude Georges Picard - Préface de Jean Charles Jauffret - Les Editions du Net, 2013,232 p.)
Ce livre date de 2013, les événements invoqués de plus de 50 ans, mais il reste d’actualité. J’ai fait la connaissance de Claude Picard à Montpellier, lors d’une journée consacrée à l’écriture des journaux intimes. Du 10 Janvier 1961 au 7 février 1962, il a tenu le sien quotidiennement dans la dernière année de la guerre d’Algérie, un journal magnifique où il dit à plusieurs reprises l’importance de l’écriture, celle d’aligner les mots, tout pétri qu’il est de littérature et de poésie. De cette guerre absurde, de l’ennui, il tente de s’échapper en faisant l’instituteur dans un village reculé de la Kabylie, Imaghdacene, mal traité parce que non rallié, « rebelle » : les femmes n’ont donc pas le droit aux rations, les enfants pas le droit aux vaccinations. Dans ce poste militaire isolé à 1200 mètres d’altitude, le piton, cet appelé est soldat mais aussi instituteur-infirmier-écrivain public.
Complice involontaire, il a conscience et culpabilise de son double jeu de viril soldat et de bon instituteur, comme la France jouait alors double jeu : « J’endosse mes deux rôles : solidaire de mes compagnons sur le terrain, solidaire du malheur des enfants d’Imaghdacene. »
Ainsi à 15 jours d’intervalle il décrit le 2 mars 1961 les premiers contacts avec ses 152 élèves répartis en 3 classes et les joies profondes et multiples qu’il en tire. Mais le 28 mars : « Je suis fatigué, fatigué de ne pas comprendre, fatigué de l’intolérance, de la solitude, de ce racisme indéracinable qui nous habite tous, du pourrissement de cette guerre, épuisé de tenter de comprendre les pourquoi et les comment de ma vie ici et ailleurs si las de laisser ici « pitonner » ma jeunesse. »
Lucide, il transcende son malaise par l’écriture, constate : « Je m’accroche à ces pages comme un naufragé à sa bouée. Dire, écrire le rien qui m’habite n’est pas chose aisée. Cette vie, le vide de moi-même et cette vacuité déteint sur le papier. Impossible de comprendre ce monde sans avenir. La laideur du treillis ne déteint elle pas sur l’âme ? »
Déchirement personnel, schizophrénie, ce sont aussi ceux de son pays : « Qu’importe si nous gagnons la guerre sur le terrain, si la France ici dans ce village perd son prestige et son honneur ? Les enfants d’Imaghdacene ont aujourd’hui assez de haine et de mépris pour devenir de bons fellaghas. »
A son départ, le 7 février 1962, il évoque le temps de l’oubli qui commence, mais lui n’oubliera pas et c’est pourquoi ce journal, rédigé comme une nécessité, reste actuel.
Revenu en Kabylie en 1975, il reçoit un accueil chaleureux des habitants d’Imaghdacene, c’est en 2014 que lui est décernée par le village une « déclaration de reconnaissance méritoire »
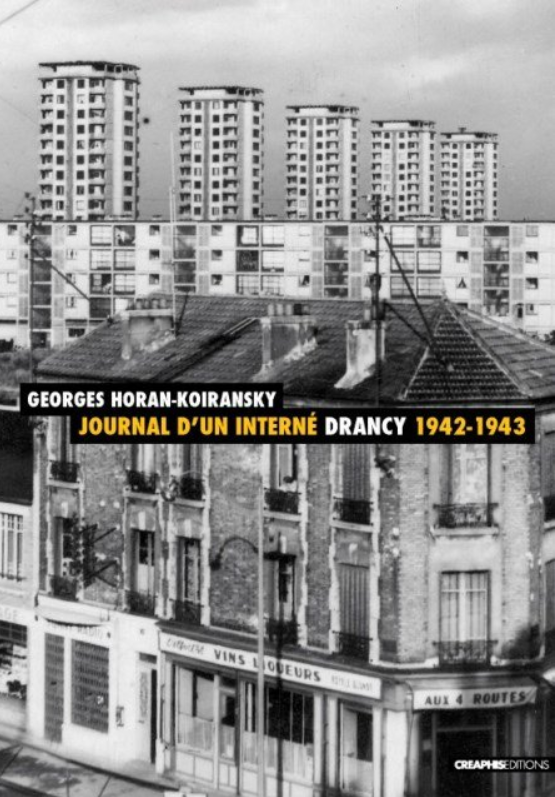
Véronique Leroux-Hugon parle du livre "Journal d’un interné. Drancy 1942-1943"
Note de lecture de Véronique Leroux-Hugon – 07 septembre 2018
Comme on le sait, les journaux sur les camps de transit français, dont Drancy durant la seconde guerre mondiale sont nombreux, grâce notamment à l’activité éditoriale de la Fondation Mémoire de la Shoah. Celui de Georges Horan-Koiransky est hallucinant, illustré, si l’on ose dire, par un volume d’estampes publié en 1947 et réédité en 2017 avec le même titre : « Le camp de Drancy, seuil de l’enfer juif. Dessins et estampes 1942-1947 » Créaphis publie parallèlement le journal à partir, non du manuscrit original, mais d’une version dactylographiée postérieure. Cette publication est fondamentale, tant y transparaît la personnalité de son auteur, la rigueur et la profondeur des observations du grand dessinateur qu’il est, visibles dans son écriture et dans les dessins évoqués. Cette édition est précédée d’une introduction de Benoît Pouvreau complétant en notes les entrées du journal par un catalogue terrifiant des déportations au jour le jour vers Auschwitz, auquel il ajoute une courte biobibliographie.
On peut envisager la lecture de ce journal sous trois angles : un constat précis, incontournable, sur la vie à Drancy, sur la préparation des convois, la déportation d’enfants décidée par le gouvernement français. L’auteur évoque aussi son statut particulier de juif « NARJ », on y reviendra. Enfin se découvre la personnalité de cet artiste, désespérément en quête de papier pour ce témoignage graphique, auquel fait allusion Thomas Fontaine dans sa préface.
« 16/04/1943 : J’écris ceci pour moi. Pour me libérer d’une obsession… je suis intoxiqué de Drancy, saturé [par la] maléfique influence de ces images : je n’ai qu’un moyen de leur échapper les fixer sur le papier. »
Arrêté le 11 Juillet 1942, l’auteur rappelle le 22 juillet: « Je renouvelle ma volonté d’être l’enregistreur et le transcripteur fidèle de ce que je verrai. Ce sera une création douloureuse. »
Dans des entrées irrégulières, il pose un regard attentif parfois humoristique sur la vie quotidienne au camp, son (in)organisation matérielle, les arrivées et départs incessants dans une pagaille étonnante, les exactions et pillages des PQJistes (Police des Questions Juives) dont il dit : « Les simili-inspecteurs Péquijistes continuent leurs manigances et la puanteur de leur propos égale celle de leur âme » ; il énumère le cours des denrées de base, orchestré par les mêmes trafiquants. Chargé d’aider à l’organisation des convois, il décrit la mécanique des transferts, les rouages de la machine à déporter. Particulièrement choqué par le sort des enfants, il note, le 15/08/1942 : « Ste Marie mère de Dieu ! C’est votre fête ! Le fruit de vos entrailles est béni ! ». Un millier d’enfants viennent de recevoir la bénédiction divine et sont internés dans le camp »
Par de nombreuses remarques il excelle à faire ressentir l’angoisse permanente qu’engendrent les rouages du monstre, l’horreur, le soulagement bref (il quitte Drancy pour Pithiviers et Beaune La Rollande pour réintégrer Drancy quelques jours plus tard) : « Un peu de repos ne me nuira pas… ne plus voir toujours ces horribles scènes ne pas pétrir cette argile humaine de désespérance et d’angoisse. »
Cette angoisse, il va la connaître pour son compte dans les derniers jours, à guetter son nom dans la liste des déportables. En effet Georges Horan-Koiransky a le statut un peu spécifique de NARJ : initiales terribles qui signifient : Non Appartenance à La Race Juive. En principe, ce statut proclamé à Nuremberg en 1933 préserve de la déportation les conjoints d’aryens, à condition qu’ils puissent en produire le certificat, celui que sa femme va présenter très tôt lors de son arrestation mais qui tardera à être reconnu. Caustique il ponctue ses notes de : « Qui veut des maris d’aryennes ? » et remarque : « Le fait d’avoir épousé une aryenne était l’indice d’un abandon de la race juive en faveur de l’aryanisme. J’aurais pensé quant à moi que la contamination d’une aryenne par un abject juif était une aggravation ».
Ce statut va néanmoins permettre sa libération le 13 mars 1943 ; il explique aussi la spécificité de son regard sur ces huit mois d’emprisonnement, la qualité d’observation d’un artiste témoin infiniment précis. Toujours en quête de papier pour dessiner, quand on ne lui confisque pas les feuilles envoyées dans les colis hebdomadaires, il dessine avec les moyens du bord, signale par exemple sur l’architecture de Drancy : « et moi qui ne vis que par les couleurs, les lumières, les peintures, les formes, les traits, les oppositions des ombres et des lumières, gratte-ciel de Drancy je vous ai vus en peintre et non pas en interné ». Le 21 juillet, il observe les douches : « Je regarde les anatomies ridiculement terribles échappées du délire de quelques nécromanciens flamands et ressuscités par quelques esprits blasphémateurs. »
Réservé sur le judaïsme, il demeure sensible à la célébration du Grand Pardon dans le camp en septembre 1942 : « Tout Israël est là, dans sa douleur, sa confession, sa misère, sa déportation. »
Il faut lire et relire ce texte cathartique relatant 8 mois d’internement après lesquels, libéré en mars 1943, il se fabrique de faux papiers, se cache et s’engage dans la Résistance.
- La note
- Fiche du livre
- Livre d'histoire : "Drancy, un camps de concentration très ordinaire", Maurice Rajsfus, 1996
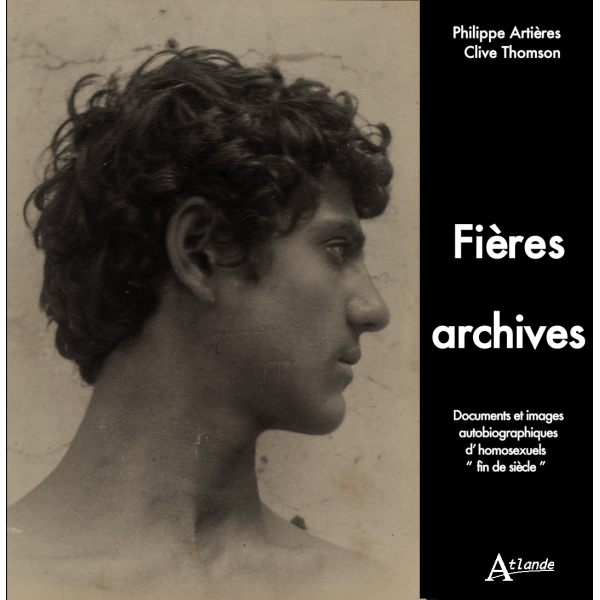
Fières archives : des homosexuels fin de siècle
Un article à propos de l'exposition et de son catalogue : Fières archives : Documents et images autobiographiques d'homosexuels "fin de siècle"
Cet article est paru dans "LA FAUTE A ROUSSEAU" n° 76-octobre 2017 (article reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteure).
"L'affiche d'un garçon au profil grec a invité jusqu'à fin août à une passionnante exposition à la Mairie du IVe (Paris) sous le beau titre de "Fières archives". Philippe Artières et Clive Thomson en sont les commissaires, auteurs aussi d'un livre qui en amplifie l'intérêt.
Le propos : donner à voir des documents autobiographiques d'homosexuels "fin de siècle", à partir de l'immense collection constituée par Georges Hérelle. C'est aussi décrire les étranges rapports instaurés fin XIXe siècle entre les grands absents de l'histoire, les invertis, pédérastes et autres sodomites et le savoir, donc le pouvoir médical...".
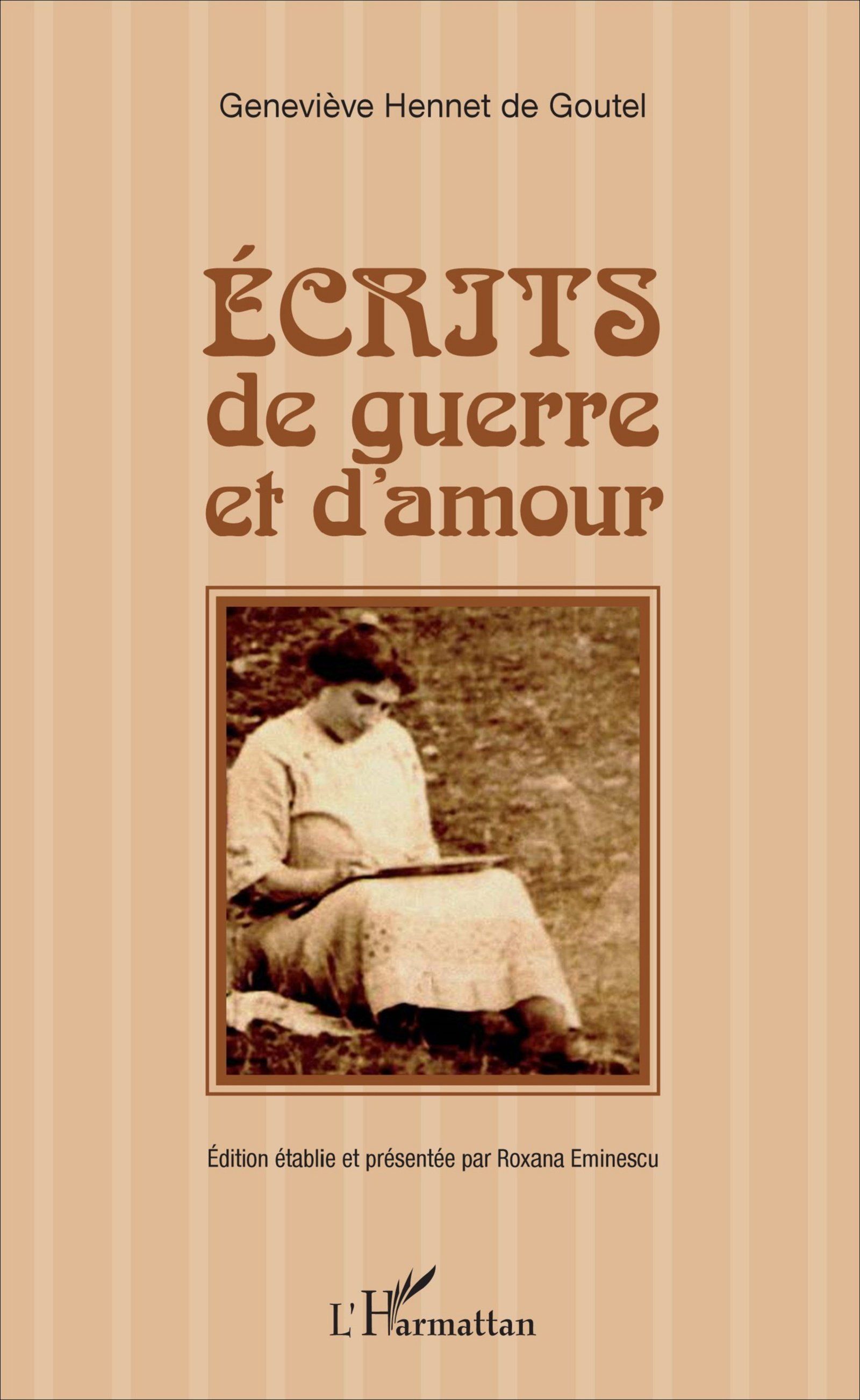
Geneviève Hennet de Goutel : écrits de guerre et d'amour
Note à propos du livre "Ecrits de guerre et d'amour" de Geneviève Hennet de Goutel (16 octobre 2017)
En 1916, on a proposé à Geneviève Hennet de Goutel de se charger d’un hôpital de la Croix-Rouge en Roumanie. « Cela tente la Gen aventureuse, la Gen organisatrice, la Gen infirmière aussi, cela tente aussi la petite Française d’aller porter très haut là-bas le drapeau de la France et de le faire aimer encore davantage », écrit-elle.
Cette remarque caractérise bien le ton des écrits de Geneviève Hennet de Goutel (née en 1885), formée à la Croix-Rouge et bien décidée à participer à la guerre, car elle avait essayé par deux fois de s’engager au front. Elle va accepter avec enthousiasme la proposition de partir avec la Mission sanitaire française, le 4 octobre 1916....

La pratique autobiographique des cheminots
Un article paru dans Paru dans "Revue d’histoire des chemins de fer", 44 | 2013
Résumé
L’Association pour l’Autobiographie (APA) s’est donné pour but de recueillir, conserver et valoriser les écrits du moi, sous des formes diverses telles que récits de vie, journaux intimes, correspondances
.
Dans cet ensemble les vies de cheminots ont leur place, d’autant plus que le siège de l’Association est à Ambérieu, nœud ferroviaire important, et a reçu de ce fait plusieurs textes de déposants vivant dans l’Ain.
Un repérage dans le fonds de l’APA a permis de constituer un corpus d’une quarantaine de dépôts : ceux de 19 personnes ayant travaillé dans les chemins de fer (non exclusivement cheminots) et ceux de 18 descendants évoquant le travail de leur père et leur propre parcours. Il faut noter d’emblée que ces textes peuvent être consacrés en totalité à la vie professionnelle mais qu’ils le sont plus fréquemment en partie seulement. La présentation de ce corpus sera l’occasion d’évoquer la description des conditions et du vécu du travail, tels qu’ils apparaissent dans ces écrits précieux pour la transmission d’une mémoire du travail, témoignant également des trajectoires sociales (qui furent le thème des Journées de l’APA en 2011).