Notes de lecture de Régine de la Tour
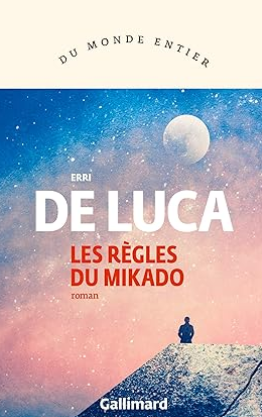
Alter Egaux
Une note de lecture à propos du livre d'Erri De Luca "Les règles du Mikado" (29/06/2024)
Nous sommes probablement assez nombreux à avoir joué, où à jouer encore, à ce jeu, tout à la fois de patience et d’adresse, le Mikado. Les règles semblent, somme toute, assez simples. Après avoir laissé tomber en éventail le paquet de quarante et une baguettes, il s’agit de les retirer une à une sans faire bouger les autres.
« Certains voient la vie comme un fleuve, certains comme un désert, d'autres comme une partie d'échecs avec la mort. Moi, je la vois sous forme d'un jeu de Mikado en solitaire ».
Le nouveau roman d’Erri de Luca, c’est l’histoire d’une rencontre.
Elle, c’est une jeune gitane. Elle a quinze ans. Elle fuit sa famille pour éviter un mariage arrangé. Lui, c’est un vieil horloger qui a l’habitude de camper, seul au sommet d’une montagne à la frontière Italo-Slovène. Une nuit d’hiver, elle fait irruption sous la tente du vieil homme pour y trouver refuge.
Elle, est rebelle, elle ne sait ni lire ni écrire, elle croit au destin, aux lignes de la main. Son meilleur ami, un ours, et pour la protéger, un corbeau. Lui, vit seul, a gagné beaucoup d’argent en Suisse, mais ce n’est pas ce qui l’intéresse. Il a créé une fondation pour des sans-abris. Il est étonnamment calme, lucide, imperturbable, patient. Il voit le monde comme un jeu de Mikado dans lequel un mouvement imperceptible peut en changer le cours.
- « C’est impossible de prendre un bâtonnet sans faire bouger les autres »
- « On dirait, oui mais chaque position a un point d’équilibre »
On ne connaitra pas leur nom. « Ils ne comptent pas pour moi » explique Erri de Luca dans sa préface. « Ils n’ajoutent rien. Au contraire, ils retirent. »
Dans une construction originale qu’on ne dévoilera pas, un style dépouillé, une langue épurée, faite de mots et de silences, Erri de Luca raconte l’histoire d’une amitié improbable qui se noue jour après jour entre ces deux personnages énigmatiques que tout oppose.
Une rencontre fortuite ?
Ils finiront par se séparer au bord de la mer Adriatique. « Donne-moi des nouvelles de ta vie ». On n’en dira pas plus.
Les règles du Mikado est un roman d’apprentissage, de transmission, où « La poussière dérègle les montres parce qu'elle veut être celle qui mesure le temps ». Il y est question de montagne et de mer, de complexité de l’identité, de vie, d’engagement, de liberté et de fraternité.
C’est peut-être aussi un peu un roman policier !
Mais comment ne pas y voir des liens avec la vie engagée de l’homme, Erri de Luca, pour qui il n’y a pas de « clandestins » dans ce monde, juste des « voyageurs ».
En italien « Mikado » se dit « Shangaï ». Qu’on aimerait savoir lire l’italien.
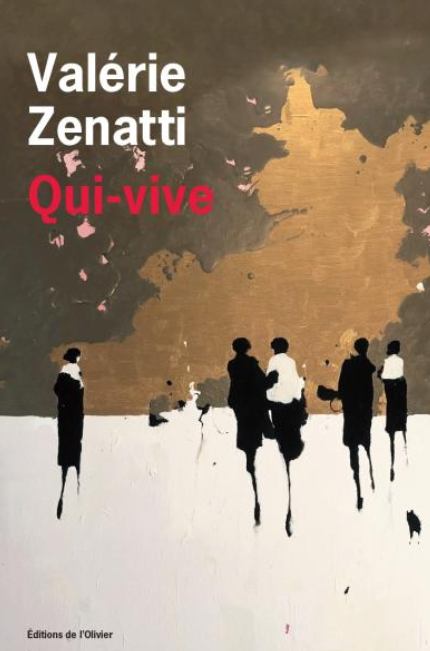
A « l’orée d’un silence »
Une note de lecture à propos du livre de Valérie Zenatti "Qui vive" (29/06/2024)
Le 8 novembre Donald Trump est élu. Le 11, Mathilde apprend la mort de Leonard Cohen. C’est probablement à ce moment que tout a commencé. D’habitude, c’est la fin d’un livre qu’on ne dévoile pas. Dans Qui vive, le dernier roman de Valérie Zenatti, l’incipit non plus ne sera pas totalement dévoilé. Et si ? s’interroge Mathilde. La réflexion de Mathilde sur la conjonction des événements est étonnante.
Mathilde est professeure d’histoire. Elle a un mari, Julien, et une fille, Lola. Les événements dramatiques se sont succédé : les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, le Covid et son confinement, la guerre en Ukraine…. Mathilde est "percutée" par les événements du monde.
Hypersensibilité, perte du sommeil, du sens du toucher, de son grand père, une mort en si bémol majeur. Et puis il y a ces dix feuillets de son grand père, très énigmatiques, retrouvés après sa mort. L’histoire inachevée d’un violon fabriqué à partir d’un arbre. Et surtout, il y a cette vidéo de Léonard Cohen quittant la scène à Jérusalem. Quatre minutes et deux secondes qu’elle va regarder de façon obsessionnelle. « Il y a des nuits où l’on vole et d’autres où l’on ne parvient pas à décoller ». « Je ne peux pas tricher ».
« Rien ne va plus ». La donne est là. Mais les jeux ne sont pas faits. Au contraire, la partie commence.
« Quand on perd pied, il faut retourner à la source ». Sur un coup de tête, Mathilde part. Elle laisse mari, fille, famille, élèves. Pour où ? Elle ne le dira ni à Julien ni à Lola. « Juste comprenez-moi, je ne veux pas tricher », « Je veux aller vers l’inconnu, le coruscant peut-être ». « Tu ne peux pas t’exprimer normalement » lui répondra Lola.
Fuite ou échappée ? Mathilde va prendre l’avion, décoller. C’est vers Israël qu’elle s’envole. La réponse à ses questions se trouverait-elle dans ce pays où elle n’est allée qu’une fois, à six ans, et dont elle parle parfaitement la langue ? Agis d’abord, tu comprendras après, dit le Talmud.
Mathilde va arpenter ce pays. Road trip ou errance ? Des villes et des inconnus, ou non. Tel Aviv, « parce que la moiteur respirée en sortant de l’aéroport m’a intimée de commencer par-là, la plage bleue infinie ». Capharnaüm, le chaos ? ou Kfar Nahum le village de la consolation, en hébreu ?
Le voyage s’arrêtera à Jérusalem.
Elle fera aussi des rencontres. Ofek, dans l’avion, qui fuit un milieu juif orthodoxe. Raphy, à Tel Aviv, son cousin, qu’elle n’a pas vu depuis ses six ans. Elle veut savoir s’il a assisté au concert à Tel Aviv en 72. « Non mais j’ai mieux que ça. ». On vous laisse découvrir ! « Mais dis-moi, tu n’as pas fait quatre mille kilomètres pour demander à un vieux cousin que t’as vu qu’une fois dans ta vie de te raconter ses souvenir de Leonard Cohen, si ? »
Il y aura aussi Constance Khan, qui va mettre en scène une pièce sur la destruction du deuxième Temple pour la jouer sous les remparts à Jérusalem. Et si ?
Il y aura encore et toujours Leonard Cohen. The Partisan, So long Marianne, Suzanne, Bird on the Wire… la toile de fond du roman, comme une bande son traversant l’ensemble du texte et accompagnant Mathilde pendant son voyage. "Il y a, chez Leonard Cohen, cette dimension mystérieuse de la condition humaine" confie Valérie Zenatti à Jean-Baptiste Urbain sur France Musique.
Qui vive est un texte grave. La légèreté viendra de Lola et aussi de Raphy avec leur humour très décalé. Qui vive sonde la confusion des sentiments. Dans une langue traversée par l’émotion, Valérie Zenatti explore avec précision l’intime et l’histoire du monde. Quand elle explique qu’Edna prépare une salade, elle écrit « tout en parlant, elle détaille des tomates et des concombres en petits cubes ». Voilà, la traductrice et amie d’Aaron Appelfed, « détaille ». Le verbe a son importance. L’autrice de En retard pour la guerre, Jacob Jacob, Une bouteille dans la mer de Gaza, décrit, expose, développe dans une langue tout à la fois sensible, originale, subtile, les méandres de la complexité du monde.
La force de Qui-vive tient aussi au fait que si Mathilde ignore tout ou presque d’Israël, le pays rêvé, Valérie Zenatti connait dans sa chair le pays réel. Dès lors ce texte profond est nourri de la puissance d’une expérience qui vient alimenter un parcours initiatique, une quête de soi, de sens intense.
Qui vive a été écrit bien avant le 7 octobre. Le roman prend désormais un relief particulier. Où est Mathilde aujourd’hui ? Probablement déchirée, certainement humaniste, peut-être même a-t-elle rejoint le mouvement des Guerrières de la Paix ?
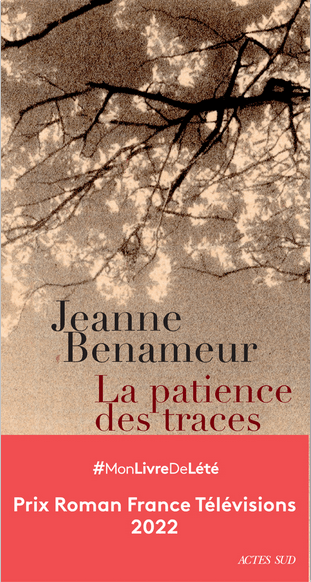
Réparer les fêlures
(à propos de "La patience des traces" de Jeanne Benameur)
Peu à peu, Simon avait « appris à écouter chacun de ses patients comme on écoute un chant ».
Simon Lhumain, c’est son nom, « un comble pour un psychanalyste » non ? Son temps, il le passe à écouter les autres, au risque de s’oublier, au risque de taire sa propre histoire. Ce matin, son bol, bleu, lui a échappé des mains. Le bol s’est brisé. « Les deux parties ne pèsent pas le même poids » et c’est sa vie qui vient de basculer.
Simon va arrêter son travail. « Il a besoin de commencer un autre chemin ». Il va quitter sa ville, son île, son océan. Commence alors un lent voyage à l’écoute des silences.
On rencontrera Louise, le premier baiser échangé avec son amoureuse d’adolescence et aussi Mathieu son ami d’enfance, son frère. On rencontrera Mathilde, une jeune consœur qui s’est installée dans l’île il y a un an. Ils ont pris l’habitude de se voir de temps en temps. Il y a aussi Hervé et leurs parties rituelles d’échec. C’est Hervé qui encouragera Simon à aller au Japon. Et puis il y a Lucie F. cette patiente « qui ne savait pas « habiter » […] Elle occupait des maisons, des appartements qu’elle achetait, Elle y vivait un peu puis elle mettait en vente, refaisait ses cartons et repartait. » Un jour elle n’est plus jamais revenue dans son cabinet. Maintenant Lucie F. l’obsède.
Simon part pour les îles de Yaeyama, au Sud du Japon. Un aller simple pour une terre encore peu connue. Simon part pour se trouver, se retrouver. Il est accueilli par Madame Itô. Elle tient une maison d'hôtes. Elle collectionne des tissus et des vêtements anciens qu’elle range précautionneusement dans une armoire. Parfois l’étoffe a une odeur « légèrement safranée ». Madame Itô parle un « français délicat et presque sans accent ». « Ne soyez pas étonné, j’ai fait des études de lettres à la Sorbonne en mon temps ». Monsieur Itô, Daisuke, son mari, ne parle que japonais. Il est céramiste. Il sublime les cassures et les fêlures avec un fil d’or. Daisuke est maitre dans l’art du kintsugi. « Ces deux-là vivaient du mieux qu’ils pouvaient, de toute leur âme ».
La chaleur des journées, la tiédeur de l’eau, marcher, marcher encore, nager jusqu’à l’épuisement, les rencontres, la langue qu’on ne comprends pas, les rituels, les contes mystérieux, les cérémonies, l’art de réparer... La patience des traces explore les facettes de l’intime, invite à l’apaisement, fait avancer doucement et calmement à travers les chemins de traverse, les chemins des souvenirs menant lentement et délicatement à la liberté.
Les phrases sont courtes, comme autant de fils qui tisseraient les silences aux mots d’une trame délicate. Tissage poétique, échappée mélancolique.
A lire et même à relire
Extrait 1
« Il se laisse aller à cette sorte de langueur qu’il n’a jamais éprouvée.
Toute sa vie passée à écouter les autres. Il n’écoute plus personne. Il y a là une paix profonde et une tristesse. Aussi profonde l’une que l’autre. Il vient de déposer l’habit. Pas défroqué, non, parce que sur sa route il n’y a ni dieu ni vœu éternel. Il s’éloigne simplement et il se sent de plus en plus nu. Parfois une question le saisit. Ecouter et parler n’est-ce pas ce qui rend plus humain chaque être ? Est-ce qu’il n’est pas en train de trop s’éloigner ? »
Extrait 2
« Daisuke parle. A sa façon lente. Entre chaque phrase, un temps. Le silence dans lequel Simon marche. S’il comprenait ce que dit Daisuke, il saurait que tout se répare. On ne cherche pas à cacher la réparation. Au contraire, on la recouvre de laque d’or. »
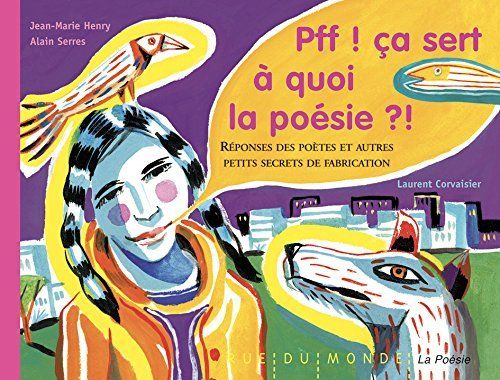
Votre boulanger sait-il que vous êtes poète ?
Une note de lecture de Régine de la Tour sur le livre "Pff ! ça sert à quoi la poésie ?! : Réponses des poètes et autres petits secrets de fabrication"
Est-ce qu’un poète peut tomber en panne de poésie ? interroge Jules, 11 ans ? Vous trouvez ça vraiment actuel de faire de la poésie ? demande Tom, 12 ans. « Les poètes connaissent-ils leurs poèmes par cœur ? »
Dans cette anthologie pour enfants, la trouvaille de Jean-Marie Henry et Alain Serres c’est, qu’au-delà du choix des textes, ils donnent la parole aux enfants et aux poètes qui tentent de répondre à leurs interrogations aussi impertinentes que spontanées.
Véritable initiation à la découverte des mystères et des merveilles de la poésie, le recueil est organisé autour de trois thèmes : « La poésie est-elle vraiment utile ? » ; « Ça se fabrique comment, un poème ? » et « Ça sert à être libre, la poésie ! ». Des poètes d’hier : Jean Giono, Paul Reverdy, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud côtoient des poètes d’aujourd’hui : Dominique Sampiero, Andrée Chedid, Abdellatif Laâbi. Quatre-vingts poèmes en prose souvent, en vers de temps en temps et même parfois en acrostiche. Une anthologie didactique rythmée par les questions, les réponses et aussi par les illustrations de Laurent Corvaisier. Elles confèrent, à ce livre au format à l’italienne, une tonalité tout à tour joyeuse et colorée ou au contraire nostalgique et douce, qui renforce l’esthétique du projet.
Une anthologie de poésie, explique Carl Norac à Paco, 9 ans, c’est un immeuble étrange où les voisins peuvent venir du monde entier… et même ne pas vivre à la même époque. Leurs mots se croisent dans les escaliers et leurs rimes dans les couloirs… ».
De belles émotions à partager entre petits et grands et l’occasion de (re)découvrir les Editions Rue du Monde dont les collections, destinées aux enfants, ont pour ambition d’« interroger et imaginer le monde ».
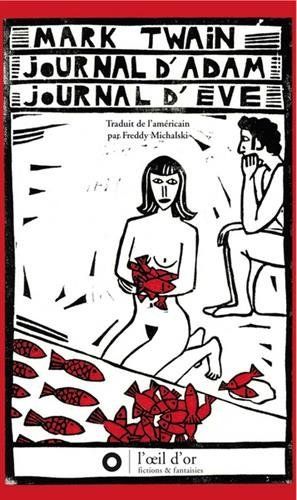
C'est pas moi c'est elle
Note de lecture de Régine de La Tour sur le livre "Journal d'Adam - Journal d' Eve" de Marc Twain
Bon, déjà il fallait le dénicher ce manuscrit originel des journaux intimes d’Adam et d’Eve. Ensuite il fallait les déchiffrer ces hiéroglyphes d'un autre temps. Alors quand l'auteur de Tom Sawyer se met à « traduire » cette trouvaille, cela donne deux petits textes plein de tendresse, d’humour et de poésie.
Rencontre d'Adam et d'Ève, découverte du monde, arrivée de leur premier enfant, un petit bijou à mettre entre toutes les mains, en français ou en anglais pour celles et ceux qui n'ont pas besoin de traduction.
Bien mieux que tout ce qu’on a pu nous raconter jusqu'à maintenant sur l'origine du monde !
Fragment :
"LUNDI
La nouvelle créature, avec ses longs cheveux, est toujours fourrée dans mes pattes. Toujours à trainer à mes basques et à me suivre comme un petit chien et je n’aime pas ; je n’ai pas l’habitude d’avoir de la compagnie. Si seulement elle voulait bien rester avec les autres animaux… Ciel couvert aujourd’hui, avec un petit vent d’est ; je pense que nous allons avoir de la pluie… Nous … Où est-ce que j’ai bien pu dénicher ce mot ?... Je me souviens maintenant — c’est la nouvelle créature qui l’emploie. »
post-scriptum 1: le titre de cette note est inspiré de l'article d'Anne Enright, The Genesis of Blame paru dans le numéro de la London Review of Books du 8 mars 2018.
post-scriptum 2 : ce livre-là, je l'ai déjà offert cinq fois. Et ça va continuer ! Je crois savoir que celles et ceux à qui je l'ai offert vont, eux aussi, l'offrir, peut-être même cinq fois. Et voilà la chaine est partie, à vous de la continuer !
post-scriptum 3 : et en v.o.
“Monday.
This new creature with long hair is a good deal in the way. It is always hanging around and following me about. I don't like this; I am not used to company. I wish it would stay with the other animals. Cloudy today, wind in the east; like we shall have rain ....We? Where did I get that word?... I remembered now — the new creature uses it.”
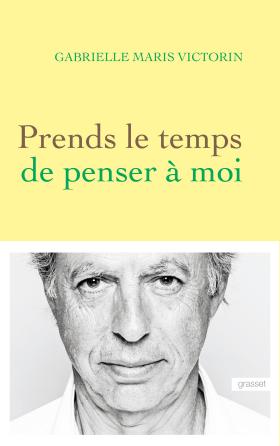
Prends le temps de penser à moi
Note de lecture de Régine de La Tour
[Prends le temps de penser à moi, Gabrielle Maris Victorin, Edition Grasset, Paris 2017, 128 p. 13,50 €]
Amour, force et douceur
« Papa, je t'en supplie, rappelle-moi... » mais le père ne rappellera pas. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2015. Il est 11 h 34. Le père, c’est Bernard Maris. Il vient de mourir dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Sa fille Gabrielle livre un petit texte lumineux, intense et émouvant.
Mais l’économiste que tout le monde connait, cet homme-là, Gabrielle Maris Victorin le reconnait à peine dans l’hommage qui lui est rendu. Elle n’écrit ni une biographie, ni un portrait, ni même un livre de souvenirs. Ce que Gabrielle exprime dans ce texte très intimiste, c’est « la seule [histoire] qu’[elle] connaisse. Celle d’un père et d’une fille ». Au-delà du drame, Prends le temps de penser à moi donne à ressentir de quoi est faite cette relation quand tout d’un coup on se souvient qu’on était une enfant son enfant. Quand on n’avait pas « pensé qu’on restait les enfants de ses parents ».
Des départs en vacances, la gaité du père, celle de la mère aussi, l’Espagne, les grands parents, Pepe de Lucia, « el son de la alfabetización », des livres, le pot rempli de crayons et le pull marin avec trois boutons sur l’épaule. Mais aussi ses mains, le grain de sa peau, les joues dont on connait la moindre ride. Gabrielle Maris prend le temps. Par bribes, Gabrielle Maris Victorin convoque ces petits riens qui restent et auxquels on se raccroche et qui font que quoiqu’il arrive le père est vivant.
En creux, on découvre aussi une facette de l’économiste, ce père gai, tendre, le papa poule, fou de sa fille et aussi cet homme élégant qui aurait voulu être écrivain.
Au fil des pages, on entre dans l’intimité du père et de la fille mais sans effraction. L’écriture est simple, la tendresse permanente. Il n’est pas possible de faire demi-tour mais le lien du père et de la fille est là, indestructible. Gabrielle Maris Victorin écrit un livre très personnel et qui aussi console, elle et nous.
Et puis il y a cette histoire racontée le soir avant de se coucher. Celle d’Athéna, cette Athéna sortie toute armée de la tête, son père, Zeus, ce coquin. Gabrielle ressemble beaucoup à cette Athéna, armée malgré tout pour affronter l’adversité.
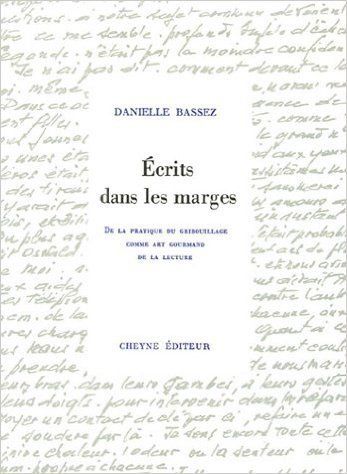
L'annotation en héritage
Note de lecture de Régine de La Tour
(Livre « Ecrits dans les marges : De la pratique du gribouillage comme art gourmand de la lecture », Danielle Bassez, éditions Cheyne, 41p., 12,50 €)
Quelles traces laisse-t-on quand on a disparu ? Le père de Danielle Bassez, lui, a laissé des gribouillis, des bouts de papier, des dessins, des listes de mots, des annotations dans des livres. Avec Ecrits dans les marges, elle partage sa part d’héritage.
« Il ne reste de lui que des traces, les notes inscrites d'une écriture aiguë, parfois minuscule, les signes cabalistiques dont il ponctue les marges : petits carrés, cercles, triangles, astérisques, sur le sens desquels on s'interroge, jusqu'à ce papier de soie s'échappant d'entre les feuillets, livrant des listes : éon, quoddité, monadologie, hapax, empirie, ontique, anamnèse, ipséité, mots dont lui, l'autodidacte, veut vérifier la signification ».
Un héritage insolite que Danielle Bassez découvre avec étonnement, amour et tendresse, et révèle dans une langue toujours ciselée, en miroir de celle de son père. « Chacun des volumes porte sa date de lecture, comme un balisage. Comme s'il avait voulu que ce chemin qu'on n'avait pas fait en sa compagnie, plus tard on le refasse, que l'on retrouve l'histoire de cette lecture, ses lieux, ses paysages, cette interrogation qui le menait parmi ces flots de pages, aussi tenace que la ténacité de celui qui les avait écrites, et qui le rendait étranger à son propre entourage.
Mosaïque décousue ces bouts de textes donnent peu à peu corps au père absent. Ils dévoilent l’intimité de ce fonctionnaire aux PTT, homme discret et silencieux, lecteur curieux, passionné et gourmand qui lit sans discrimination et sans préjugés de la littérature haute ou vile. Il lit tout, tout le temps, partout. Il lit un stylo ou un Bic à la main. Lire et écrire sont indissociables. Il écrit dans cette zone vierge autour du texte, dans le blanc de la page. Tantôt laboureur, tantôt promeneur, le père creuse, décortique, fouille, scrute les mots et les phrases. Il dialogue dans les marges avec Proust et se dessine alors un sentiment de fraternité avec lui « une même mélancolie pour l’enfant solitaire ». Dans celles de Vladimir Jankélévitch, il interroge ce philosophe « qui va du même pas ». Dans la marge des souvenirs d’un mineur se décèle son appartenance au milieu dur et austère des corons. Et tant d’autres encore. Les chemins de traverse, empruntés par le père et dans lesquels la fille engage ses pas, propose une sorte d’anthologie littéraire confidentielle et insolite, construite sur une mise en abyme subtile et passionnante dans laquelle les auteurs et les lecteurs se répondent et se confondent.
Ecrits dans les marges fera changer d’avis tous ceux qui pensent que corner une page ou annoter un livre est un véritable sacrilège. C’est tout au contraire un acte d’amour, cadeau fait à celui qui saura y prêter attention. Bien loin de la rentrée littéraire, découvrir ou redécouvrir cet opuscule de 41 pages, paru il y a un peu plus de 10 ans, en avril 2006.
Le texte d’Ecrits dans les marges est composé en Didot 10, imprimé sur papier bouffant crème à l’encre bleue ce qui lui confère un charme tout particulier. A l’image de l’écriture de Danielle Bassez et de celle de son père, aucun détail ne sera laissé au hasard par un éditeur typographe lui aussi passionné et exigeant.

Comment tu parles de ton père
Note de lecture
« Perdre son père au détour de la quarantaine, c’est banal comme une chanson de Bruel. Et je ne sais pas comment on s’en relève ». Et voilà très probablement comment à cause de (ou grâce à) cette phrase prononcée sur les ondes de France Inter un samedi matin de la fin du mois d’août j’ai commencé ma rentrée littéraire avec «Comment tu parles de ton père » alors qu’il y a 560 livres qui débarquent dans les rayons.
« Ça fait trois semaines que papa est mort » [.…] « Je n’y vois plus rien » [….] « Moi, maman est morte quand j’avais trois ans ». Un livre qu’on ne résume pas. Mais on pourrait aussi dire que le fond du récit tient à peu près dans ces trois phrases.
Séparé de sa femme, Sfar est en vacances en Crète avec ses deux jeunes enfants. Il ne voit plus rien et il est convaincu qu’il est victime d’une malédiction divine parce qu’il n’a pas assez prié pour la mort de son père. « You have tears, but they are bad. » lui explique l’étrange docteur Gorgounioux, ophtalmologue crétois qu’il est allé consulter.
Papa, si je fais un livre sur toi, ça compte pour ton âme ? Commence alors une longue prière d’un genre nouveau, une oraison funèbre, pudique, drôle, émouvante, un Kaddish iconoclaste, mais pas tant que cela, pour un père mort mais aussi pour une « mère partie en voyage ». Cette prière de la religion juive, lue à la mémoire des parents disparus, tous les jours pendant 12 mois, jusqu’à la date anniversaire.
Et de suivre le petit Joann dans un univers pour le moins baroque et dans une chronologie totalement fantasque qui est surtout celle du fil de sa pensée, celle d’une psychanalyse ? Joann Sfar écrit comme il parle, et l’oraison s’écoute au moins autant qu’elle ne se lit. Il écrit cru, parfois très cru même, il écrit ému, il écrit tendre, il écrit sensible, il écrit énervé. On pleure avec Joann, on rit avec Sfar, La Crète, Metz, Nice, Paris, et aussi Sétif en Algérie défilent. Comment tu parles de ton père donne à comprendre comment s’est construit l’auteur du Chat du Rabbin, comment on s’accorde ou pas, se débat ou pas avec sa religion, comment on vit ou pas avec le mensonge, à commencer par celui sur la mort de sa mère. « Il ne faut pas, sciemment, mentir à son gosse. Sinon il passe sa vie à raconter des histoires ». Un grand-père qui lui dira la vérité et pour lequel il ressentira beaucoup de gratitude. Sandrina, rencontrée à l’âge de 13 ans, sa femme, la mère de ses enfants. Au grand dam de son père elle n’est pas juive. Il sera heureux avec elle et il la quittera malgré tout. Et un père, ce père d’une complexité folle. « Mon père c’est pas rien ». Fragilisé par la mort de sa femme, ce juif Séfarade, brillant avocat, aux mœurs autrefois légères s’endurcit jusqu’à devenir un religieux exigeant. Il mène aussi une vie digne des héros de cinéma, défend la pute et le truand, homme à femmes prêt à faire le coup de poing quitte à être interdit de prétoire, il séduit, beaucoup. Un père omniprésent auprès de Joann. Père et mère à la foi(s). Un homme dont « le seul cadeau » qu’il ait fait à son fils « c’est de ne pas savoir dessiner »
Le livre se lit vite, d’une traite, difficile de couper la parole à quelqu’un qui en a gros sur le cœur. L’année est passée. Le kaddish aura-t-il participé à l’accomplissement du travail de deuil ? Se relève-t-on jamais de la mort de ses parents ? « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes »[1]
---
[1] Calet, Henri. Peau d’ours. Editions Gallimard. Paris, 1958.
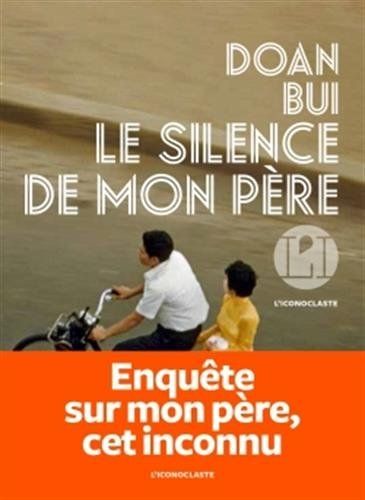
Le silence de mon père
Note de lecture
Le silence de mon père est un récit tendre, drôle, émouvant, pudique et flamboyant. « Je ne sais pas qui est mon père », ce père désormais enfermé dans ce silence provoqué par un AVC qui l’aura rendu aphasique. Doan Bui est d’origine vietnamienne. “ Ma famille me paraissait vide, sans racines, sans lieux à épingler sur une carte. Un château de sable sans fondations.” Grand reporter de l’Obs, prix Albert Londres pour son reportage «Les Naufragés du rêve européen», elle réalise qu’elle ne sait rien de ses origines.
Le récit se déroule entre Le Mans, Paris et le Vietnam. Un récit sous la forme d’une enquête 2.0 où se mêlent des pages d’une tendresse infinie sur l’enfance, le père, la mère, la famille, des messages sur WhatsApp et des échanges par emails. Mais aussi des descriptions très personnelles des ruelles d’Hanoi, des aspects peu connus des subtilités de la langue et la culture vietnamienne. Un récit nourri de recherches sur Google, de conversations par Skype où se glisseront Baudelaire, Camus, Ovide, Scarlett O' Hara, Ulysse 31 et tant d’autres. Il y a aussi la délicatesse de très belles pages révélant des secrets de famille ou des blessures intimes extrêmes qui rendent le récit bouleversant.
Au-delà de l’histoire personnelle, Doan Bui rejoint l’universel en donnant à comprendre avec drôlerie parfois, subtilité toujours, la question des origines, de l’émigration, de l’intégration. Il est question de déracinement, d’exil, de honte, d’imposture, de la difficulté à être français et de "lutte des classes" entre ceux qui lisent Télé 7 jours et ceux qui lisent Télérama.
Apporter la preuve de sa nationalité française, s’adresser à l’état civil de Nantes, fouiller dans les chemises en carton du service des archives des naturalisations, Le silence de mon père résonnera d’une manière toute particulière pour les femmes et les hommes qui pour une raison ou une autre auront dû quitter leur pays d’origine et auront fait le choix de la France, pays dit d’accueil.


