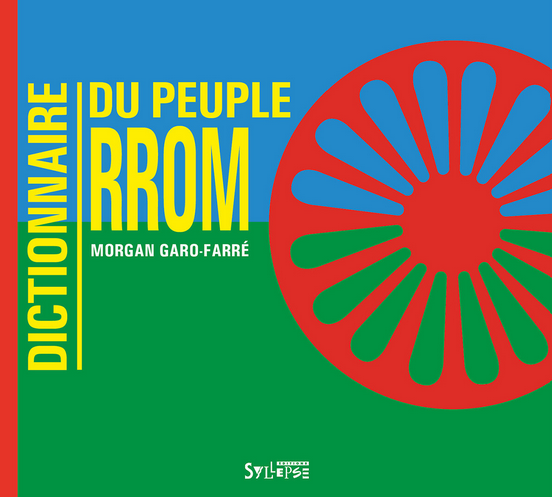Nation - Peuple - Colonialisme ...

Colonialité et système-monde capitaliste …
Entretien avec Michel Cahen
(in Entreleslignesentrelesmotss - 02 janvier 2025)
ContreTemps :
Postcolonial, Décolonial, Anticolonial… Autant de notions dont on peine à cerner les différenciations et leurs pertinences, mais qui suscitent des adhésions et des rejets aussi puissants que le plus souvent acritiques… Votre livre a pour titre Colonialité. Il se présente comme un « plaidoyer pour la précision d’un concept ». Qu’est-ce que la colonialité et pourquoi appelle-t-elle cette exigence de précision ?
Michel Cahen :
Le concept de colonialité est aujourd’hui très fréquemment utilisé, à la fois dans la pensée postcoloniale et dans la pensée décoloniale. En tant que marxiste, je m’y suis intéressé tardivement. Mais il me paraît utile au regard de la diversité des situations dans le système-monde capitaliste...
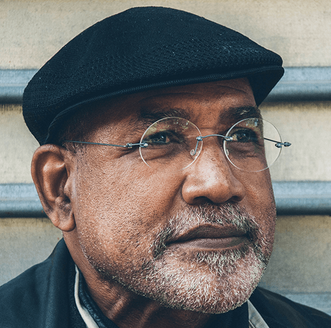
Patrick Chamoiseau : « Le “système-outremer” génère une invivabilité qui, malgré des convulsions fréquentes, ne cesse de perdurer »
Tribune parue initialement dans LE MONDE (le 29/09/2024), puis sur le site ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS (Avec l’aimable autorisation de l’auteur)
Les difficultés de la Martinique ne se résument pas à la question de la vie chère, estime l’écrivain dans une tribune au « Monde », à l’occasion des protestations qui secouent l’île. Il dénonce une économie artificielle, orientée vers la France et l’Europe, qui ignore toute opportunité pouvant surgir des Caraïbes ou des Amériques.
Le terme « consumation », emprunté à l’économiste martiniquais Michel Louis, évoque la destruction intérieure d’une société par un modèle économique mondial qui, sans contrainte apparente, souvent dans la consommation, érode ses fondements culturels, politiques et sociaux. Le jeu de sonorités, mêlant « consommation matérielle » et « consumation existentielle », résume l’une des dynamiques capitalistes des sociétés contemporaines. Le « système-outremer » français, dont relève la Martinique, n’échappe pas à cette règle. Il abrite un capitalisme mercantile qui s’ajoute à une matrice coloniale résiduelle que nos décennies de résistance n’ont pas su entamer...
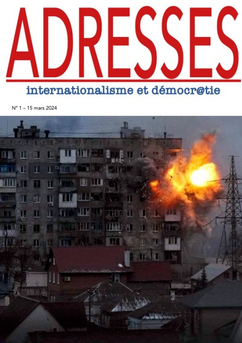
La question des nationalités (1907). Pour une « laïcité nationale »
Extrait du numéro 1 de la revue ADRESSES
Si certain·es pouvaient penser que le sentiment d’appartenance à une histoire, une culture, un destin commun, en un mot le sentiment national, allait se dissoudre, il n’en a rien été.
Catalogne, Kurdistan, Tibet, Ukraine, Fédération de Russie, Palestine/Israël, Rroms, sans oublier les multiples diasporas… partout dans le monde la question des nationalités, des peuples sans territoire, des territoires avec deux (ou plus) peuples déchire la planète et se pose aux internationalistes.
La pleine réalisation de droits des peuples est la condition nécessaire à l’émancipation de toutes et tous à la disparition des nationalismes régressifs.
Le dépassement du particulier national dans l’universel cosmopolite ne peut se faire dans la négation des traits (réels ou imaginaires, toujours mouvants) qui fondent les différentes collectivités humaines.
Un nouvel espace est à construire où, sous la poussée de la lutte des opprimés, le droit des uns sera une nécessité pour la réalisation de ceux des autres...
Déclaration du 5e congrès de l’Union internationale rromani (2000)
Extrait du livre "Dictionnaire du Peuple Rrom" (éditions Syllepse)
Les individus appartenant à la nation rrom appellent à une reconnaissance de leur nation ; mais ne veulent pas se constituer en un État, une nouvelle conception de la démocratie donnant des droits aux minorités et groupes sociaux.
Nous demandons à être reconnus comme une nation, pour les Rroms et les non rroms, qui partagent l’idée qu’il est temps de se donner ensemble de nouvelles perspectives.
Nous sommes une nation dont plus d’un demi-million de personnes ont été exterminées dans un holocauste oublié, une nation d’individus aussi maintes fois discriminés, marginalisés, victimes d’intolérance et de persécutions, nous avons un rêve et nous sommes engagés à l’accomplir...
Une cartographie identitaire de l’Ukraine en temps de guerre : thèse-antithèse-synthèse ?
Un article de Denys Gorbach, paru le 13 juin 2022
Denys Gorbach est chercheur post-doctorant au Centre Max Planck Sciences Po pour l’étude de l’instabilité des sociétés de marché (MaxPo, Paris) et maître de conférences à Sciences Po Toulouse.
"L’hétérogénéité culturelle et linguistique de l’Ukraine est un fait bien connu, dont on use et abuse pour expliquer la guerre en cours. Ayant pris racine au début de la période moderne dans la zone interstitielle disputée par trois empires – polonais, turc et russe – la nation ukrainienne s’est en effet formée par le biais de processus démographiques qui ont laissé dans leur sillage une composition multiethnique complexe aux héritages variés.
Le Sud, conquis par les Russes sur les Ottomans au 18e siècle, a subi un processus de « colonisation interne » (Etkind, 2011) qui consistait à nettoyer les terres nouvellement acquises des nomades turcophones et à les remplacer par des producteurs agraires sédentaires. Les minorités persécutées d’autres pays – mennonites allemands, Serbes ottomans, etc. ont été invitées par le gouvernement impérial et s’installent sur place. La plupart des terres, cependant, ont été réparties entre des nobles russes, qui ont amené avec eux des serfs issus des régions ethniques centrales d’Ukraine et de Russie.
Ce moment de colonisation, semblable à celui qui a eu lieu en Amérique du Nord à la même époque, a combiné des sols fertiles avec le travail forcé et a fait de l’empire russe le grenier de l’Europe..."
- L'intégralité de l'article (blog ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS)
- Lire en Anglais

Algérie : « Le désert des tartares » versus « La bataille d’Alger »
Un article de Kamel Daoud paru dans letemps.ch, le 25 juillet 2022
L’écrivain Kamel Daoud estime que le FLN, qui a libéré l’Algérie des colons français dans les années 1960, a «congelé» le pays et confisqué son histoire à force d’imposer son mouvement de libération comme seul récit national.
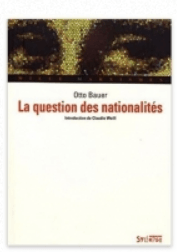
Nation, peuple, des questions…
Un article de Patrick Silberstein (10 juillet 2018)
"Cet exposé – qui est volontairement questionnant – sera quelque peu désordonné parce que le traitement de la question nous contraint à des allers-retours à la fois dans le temps et l’espace et à consulter les vieux grimoires et les vieux oracles.
Je ferai évidemment quelques incursions plus ou moins implicites dans les débats qui suivront.
Je commencerai par mentionner quelques « événements » qui nous interpellent. Très différents les uns des autres, ils ont pourtant quelques points communs à des degrés divers : ..."