
Jean-Jacques Denizard

Le Pont de Bezons
(Jean Rolin)
Rendre visite à la Seine pour un Francilien devrait être peu surprenant. Pourtant la Seine est presque inconnue pour la plupart d’entre nous. Qui pourrait, par exemple, décrire avec précision le rapprochement entre ce fleuve tranquille qui prend le temps de regarder ses habitants et ses habitants qui ne le regardent pas.
Jean Rolin est un compagnon de route de mes vacances depuis des années. Ormuz, le Traquet Kurde, l’Organisation. La rencontre proposée avec la Seine nous mène de Meaux à Mantes sans aucune halte dans la capitale. Il faut préciser et peut-être insister, Rolin n’a pas écrit un guide touristique mais un roman.
Le roman commence au pont de Bezons, avec à la page 13, un poème « heureux celui qui a vu le jour se lever sur le Pont de Bezons ». Pour assister à un tel évènement, il passera une nuit à Bezons mais il reviendra comme toujours le long de la Seine. Cette ville a changé car aujourd’hui, le tramway la relie à la Porte de Versailles. Non loin du Pont, il décrit cette fermeture d’un Mac Donald. Tout disparaît, même les bonnes frites. Il reviendra ici plusieurs fois, l’été et l’hiver. Le pont de Bezons ne possède aucune arme exceptionnelle pour se faire aimer.
J’avais lu quelques pages du livre dans une bibliothèque et j’ai trouvé rapidement la raison voire l’urgence de plonger non pas dans la Seine mais dans la lecture. En effet, après Meaux en se rapprochant de Villeneuve Saint Georges, tout change il va se rapprocher des bords de la Seine, par des sentiers de randonnées le plus souvent par des chemins de terre. La lecture va nous rapprocher des grands moments industriels des bords de Seine. Ce n’est pas à Meaux mais à côté de Bezons que les souvenirs s’allument, voire l’ouverture de notre mémoire avec l’atelier Caillebotte situé juste à côté de celui de Monet où il peignait ses coquelicots. Une rapide balade aujourd’hui suffit pour se convaincre de certains changements
Jean Rolin part vers l’ouest, c’est la rencontre avec un ami ou un historien des friches. Il nous crée des envies de découvrir ces friches. Il est sans doute possible de poser une hypothèse, notre auteur est un naturaliste. Il longe la Seine mais en fait il prend son temps et note sur son bloc pour ne rien n’oublier. Le moment de l’arrivée vers Poissy permet de répondre à un besoin avec l’hôtel Ibis de Poissy. Ce passage du livre est assez étonnant avec des descriptions très précises des friches. Merveilleuses friches, très riches. Nous sommes vraiment dans l’abandon urbain.
Ils sont nombreux à habiter ou être de passage le long de la Seine, profitant ou étant obligé de venir s’installer sur ce lieu de résidence. Ainsi vers l’Est, après le départ de Meaux jusqu’à Corbeil, la population est bien diverse avec des Kurdes et leurs cafés, dans des bâtiments qui s’inscrivent dans l’histoire francilienne. Des réfugiés Tibétains qui sont en train de prier ou encore des frères assomptionnistes, des Mac Do qui sont fermés sans trop assombrir la journée de l’auteur, en tout cas, la formule employée est ambiguë. Ce livre est passionnant car il est multiple, un moment permet de constater l’amas de pylônes, un nombre de lignes SNCF, d’usines, d’entrepôts et de plus en plus de lieux en retrait de la Seine mais sans être trop éloignés.
Il ne faut pas oublier les Humains, ils vivent souvent dans des bâtiments anciens, sans qualité excessive mais ils ne sont pas à l’extérieur dans une quechua. Dès le pont de Bezons, nous rencontrons les Roms, pas simple de prendre contact. Très nombreux à être des pêcheurs pour nourrir la famille. Et là, se situe soudainement le lieu de naissance de Louis XIV, à quelques pas, son auteur permet à son lecteur de cultiver sa richesse historique, industrielle et humaine, du bord de Seine, sous forme d’une écriture qui s’adapte parfaitement à toutes les saisons. Alors il est temps de plonger.
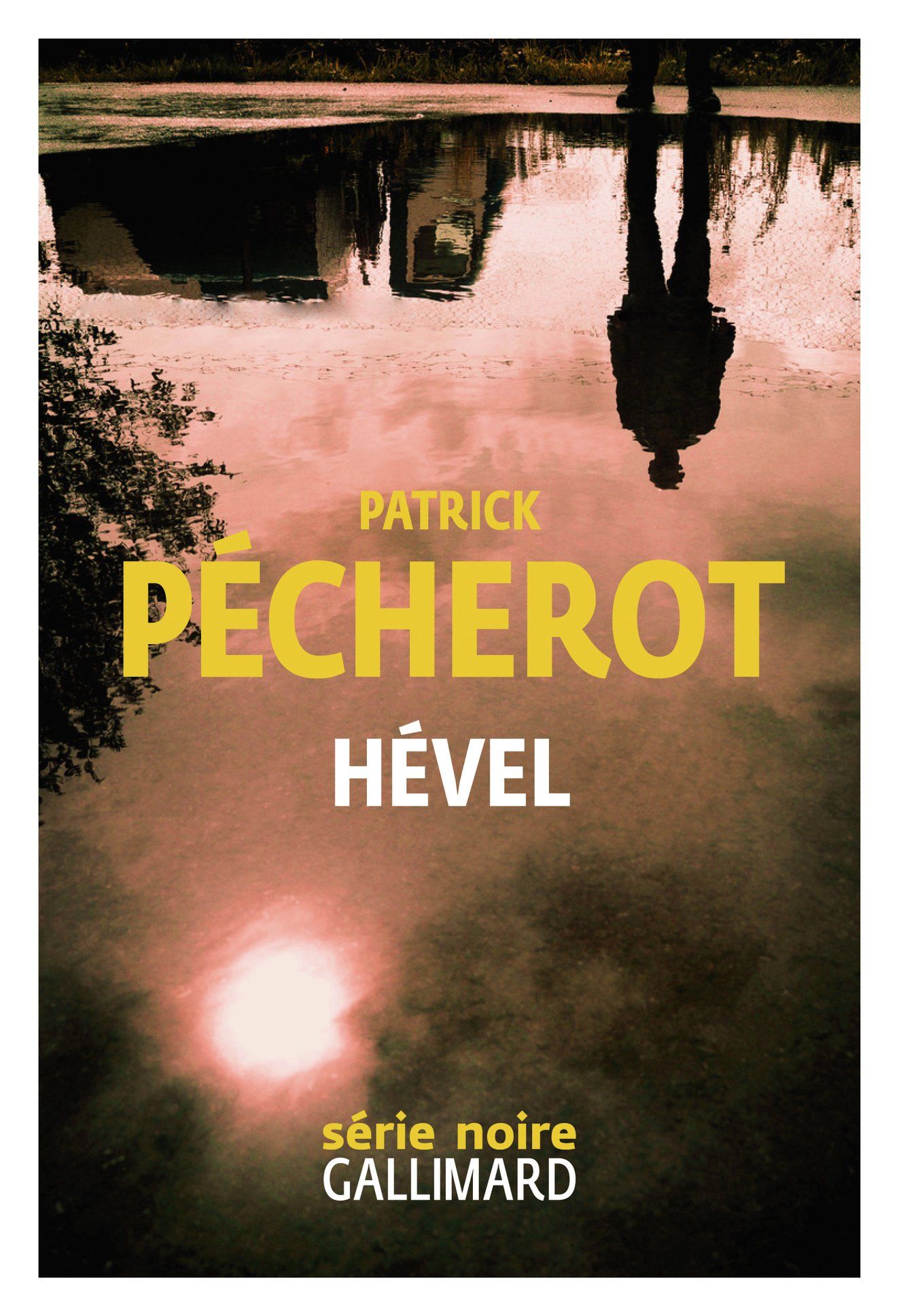
"Hével" de Patrick Pécherot
Une note de lecture à propos du livre de Patrick Pécherot - 3 août 2018
En ouvrant Hével, nous entrons dans plusieurs histoires.
La première, sans doute la colonne vertébrale du livre se déroule sur une route du Jura (pas la route 66). Les protagonistes essaient de travailler, en transportant de la marchandise (par exemple des cagettes). L’un est André, l’autre qui racontera l’histoire au journaliste est Augustin, mais il préfère pour prénom Guss. Le camion est un Citron qui souffre sur la route, son chauffeur est André (coïncidence ?). Quand il devient indispensable de changer l’essieu, l’arrêt s’effectue dans une station Azur où le Citron est monté à vide sur un pont Kromer.
La seconde se déroule en 1958, une période où la France connaissait « ses incidents d’Algérie », où « des jeunes du contingent trouvaient la mort » comme l’écrivait sobrement le journal local.
Les mots employés peuvent laisser confondre l’Algérie et le Jura « André connaissait les routes comme les bleds avec leurs noms lourds de terre ». Il ne faudrait pas oublier Simone et cette guerre d’Algérie toujours présente sur les routes au quotidien ou au passé avec une frontière avec la Suisse où les fuyards peuvent devenir déserteurs. Avec bien entendu les gendarmes qui rythmaient la surveillance des routes.
Si l’on retrouve le rythme saccadé de l’écrivain, un paragraphe compte trois pages environ. L’utilisation de l’argot apporte un côté encore plus poétique à ce livre qui n’en manque pas. Pour le titre vous en découvrirez le sens aux dernières pages.


