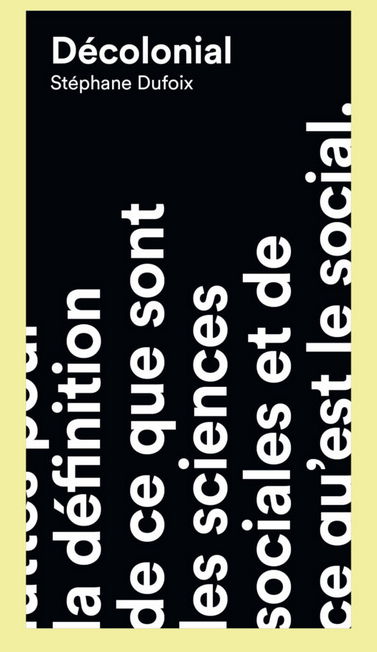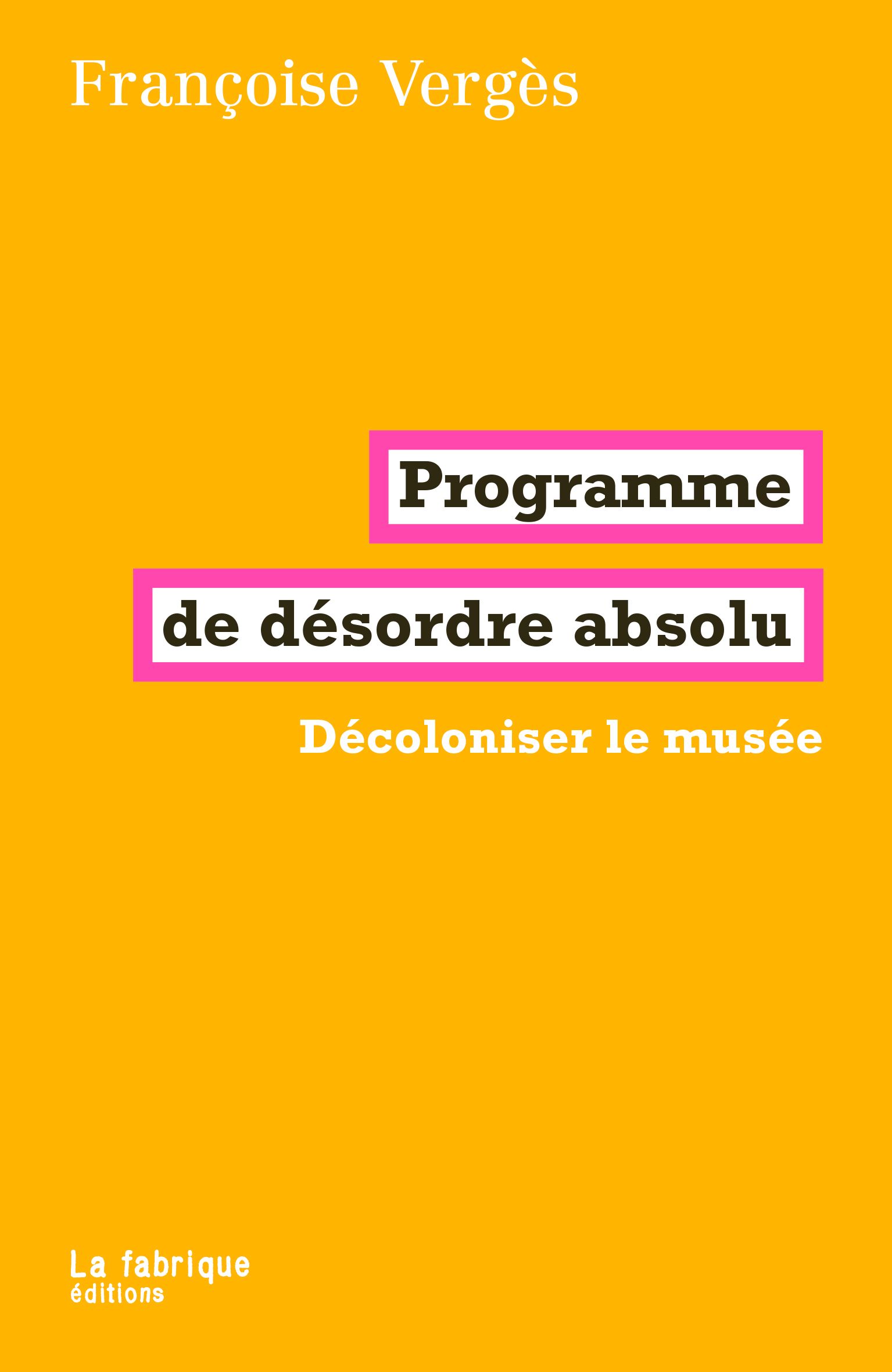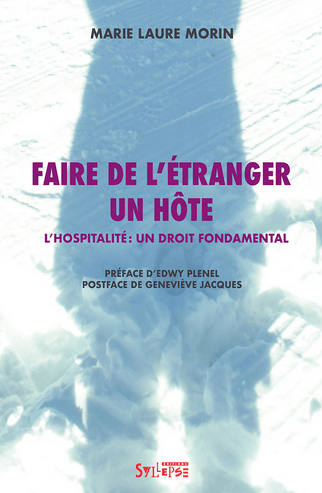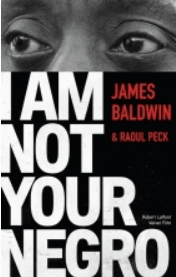Migrations - Intégration - Racisme

Les chibanis et le mythe du retour au pays
Article paru en français sur le site ballast.fr, le 19 février 2024
Chibani : en arabe, celui qui a les cheveux blanc. Un terme qui a fini par désigner, en France, l’ensemble des vieux travailleurs immigrés venus d’Afrique du Nord après la Seconde Guerre mondiale. Affectés le plus souvent aux tâches les plus précaires et dangereuses, ils ont aussi été les premiers à être renvoyés lorsque les usines ont commencé à fermer. Voici dix ans, une mission parlementaire estimait à 850 000 le nombre d’immigrés âgés de plus de 55 ans vivant en France sans pouvoir accéder aux droits que leur réservait pourtant leur âge. Depuis, leur statut s’est quelque peu amélioré, mais la situation des chibanis reste celle d’un exil sans cesse prolongé. La journaliste franco-tunisienne Maya Elboudrari est allée à la rencontre de certains d’entre elles et eux dans le XXe arrondissement de Paris, au Café social animé par l’association Ayyem Zamen. Dans cet article, paru initialement dans la revue New Lines Magazine, que nous traduisons, elle revient sur leur histoire.
- L'intégralité de l'article (ou en
PDF)
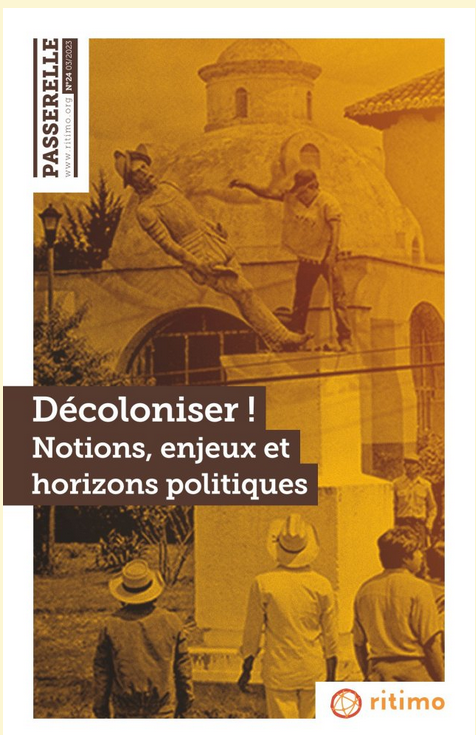
Décoloniser ! Notions, enjeux et horizons politiques
Numéro 24 - mars 2023 de la revue PASSERELLE
À travers une trentaine d’articles écrits par des chercheur·ses, des militant·es et des journalistes de différentes régions du monde, ce recueil se propose de défricher les notions, les débats et les stratégies concrètes de lutte qui agitent la scène nationale et internationale lorsqu’on parle de « décoloniser » aujourd’hui.
Ce numéro revient d’abord sur des notions souvent peu ou mal comprises – colonialité vs colonialisme, racisme d’État, personnes racisées, intersectionnalité, point de vue situé, etc. – afin d’expliciter les concepts, trop souvent brouillés par les excès des débats médiatiques et politiques.
Puis, il fait un tour d’horizon des rapports coloniaux en France et dans le monde, en se penchant sur l’« actualité » du colonialisme : qu’a-t-il engendré dans les rapports sociaux, et comment continue-t-il de façonner les sociétés aujourd’hui ?
Enfin, il propose des pistes de réflexions et d’actions pour poursuivre la décolonisation du monde : revendications autour des réparations, organisation d’espaces en non-mixité choisie, autonomisation des langues autochtones, déboulonnement des statues coloniales dans l’espace public…
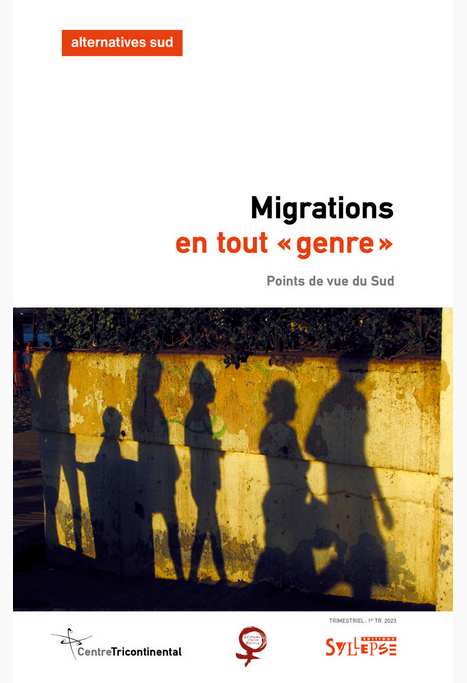
Le genre à la croisée des migrations et du travail
Présentation sur le site ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS du livre Migrations en tout genre chez Syllepse
Que fait le genre aux migrations ? Et en quoi les migrations agissent-elles sur le genre ? Ces questionnements ont rendu les femmes visibles parmi les migrants, révélé la dimension sexuée des flux migratoires et montré comme la division sexuelle du travail conditionne les possibilités d’emploi et de migration des femmes. Des opportunités existent, mais les normes de genre et les structures patriarcales demeurent résistantes aux changements...

Décolonial : penser depuis un concept controversé
Un article sur le site AFRICULTURES (le 3 mars 2023) à propos de l'essai "Décolonial" de Stéphane Dufoix
Le bref opuscule titré Décolonial, publié chez l’éditeur indépendant Anamosa donne au sociologue parisien Stephane Dufoix l’occasion de faire le point sur ce concept, conspué ou en usage, en France chez les chercheurs, les médias et les personnalités politiques depuis quelques années. Un texte nécessaire et stimulant.
Stephane Dufois situe le parti-pris de ce texte en se déclarant « sociologue blanc, mâle et de plus de 50 ans », ce qui ne l’a pas empêché, écrit-il, de remettre en cause « la vision largement occidentalo-centrée » de sa propre recherche comme de ses enseignements depuis quelques années. Dès lors, il s’est intéressé aux écrits de chercheurs des Suds tels Abdelkébir Khatibi ou Maria Lugones. Il a prêté attention à d’autres paroles, d’autres pensées afin de déconstruire l’hégémonie de la pensée occidentale. Ce geste d’intégrer des voix invisibilisées jusqu’alors, est précisément décolonial...

«L’universel dont se réclame le musée est une arme de domination coloniale»
Entretien avec Françoise Vergès à propos de son livre "Programme de désordre absolu" (DIACRITIK le 13 mars 2023)
Avec
Programme de désordre absolu : décoloniser le musée, Françoise Vergès signe un des essais majeurs de ce début d’année. À rebours de l’idée néo-libérale selon laquelle la décolonisation du musée occidental serait impossible, Vergès propose, dans le sillage de Frantz Fanon, une puissante réflexion qui repasse par l’histoire du musée, qui n’a jamais été un espace neutre. Participant à l’élaboration d’un pseudo-universel, le musée occidental est un outil de domination qui, désormais, doit être déconstruit dans un monde post-raciste et post-capitaliste. A l’heure où Emmanuel Macron annonce une loi accélérant la restitution des œuvres volées aux peuples africains, Diacritik est allé interroger le temps d’un grand entretien Françoise Vergès sur ce programme de décolonisation des musées occidentaux ...

Paap Seen : « L’ancien colonisateur continue de faire preuve d’arrogance à l’égard des Africains »
Un entretien dans LE MONDE du 21 décembre 2022
A 37 ans, Paap Seen est l’un des animateurs les plus affûtés du débat politique au Sénégal. Editorialiste et coauteur de Politisez-vous ! (United Press Editions, 2017), il porte un regard sans concession sur l’acrimonie grandissante entre une frange de la jeunesse sénégalaise et la France. Une histoire de « blessure profonde », d’« arrogance », mais aussi de destins inextricablement liés.
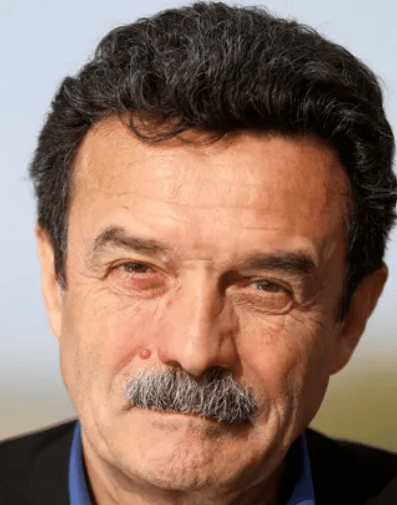
Préface d’Edwy Plenel au livre de Marie-Laure Morin : Faire de l’étranger un hôte
Publiée sur le site ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS avec l’aimable autorisation des Editions Syllepse
Quand, de retour à Ithaque, Ulysse achève son Odyssée, il prend figure de migrant. D’exilé, de réfugié, de demandeur d’asile. La déesse Athéna l’a voulu ainsi, perclus d’épreuves, vieilli par ses errances, le travestissant en misérable et le déguisant en loqueteux. C’est alors qu’Homère le fait rencontrer un porcher, Eumée, qui vit au milieu de ses bêtes. Lequel lui offre spontanément son hospitalité, sans hésiter ni barguigner, sans réserve ni condition.
À Ulysse qui le remercie chaleureusement pour « cet accueil de bonté », étonné que sa pauvre mine ne l’ait pas rebuté, le porcher répond : « Étranger, je n’ai pas le droit, quand même viendrait quelqu’un de plus miséreux que toi, de manquer de respect envers un hôte. Ils sont tous envoyés de Zeus, étrangers et mendiants. Et notre aumône leur fait plaisir, si petite soit-elle. » Puis, régalant son hôte d’un succulent rôti de gorets accompagné d’un « vin fleurant le miel », Eumée rappelle combien « les dieux bienheureux détestent l’injustice : c’est toujours l’équité que le ciel récompense, et la bonne conduite ! ».

Laure Gouraige : « La race existe-t-elle ? Mon roman fait question de cette question » (Les Idées noires)
Un entretien avec Laure Gouraige dans DIACRITIK du 10 janvier 2022, à propos de son livre Les Idées noires
Aucun doute possible : avec Les Idées noires, Laure Gouraige signe un des romans les plus remarquables de cette rentrée. Roman intersectionnel ? Récit à la croisée d’un questionnement sur la race et le social, Les Idées noires présente une narratrice en quête de ses origines à la faveur d’un coup de fil d’une journaliste qui, un jour, lui demande de témoigner du racisme anti-noir dont elle est victime. Du jour au lendemain, la jeune femme, d’origine haïtienne, prend conscience qu’en dépit de sa condition privilégiée, elle est noire. Avec une rare force, prolongeant les interrogations identitaires de son formidable premier roman, La Fille du père, Laure Gouraige donne ici un des grands romans de notre temps, celui de « Black Lives Matter » : autant de raisons pour Diacritik d’aller à la rencontre de la romancière le temps d’un grand entretien.
Ma première question voudrait porter sur la genèse de votre puissant et indispensable second roman, Les Idées noires qui vient de paraître. Comment vous est venue l’idée d’écrire l’histoire de cette jeune femme qui, un matin, suite à l’appel d’une journaliste, comprend qu’elle est « devenue noire », c’est-à-dire qui prend conscience d’une assignation et d’une discrimination identitaires par sa couleur de peau ? S’agit-il d’un récit aux accents autobiographiques qui ferait part de votre histoire personnelle, celle d’une jeune femme dont le père a des origines haïtiennes ? En quoi ce nouveau récit peut-il former un diptyque avec votre premier roman, La Fille du père, dans la mesure où vous y posez de nouveau la question de la filiation et notamment de l’étrangeté filiale ? ..."

Z ou le spectre du passé
Un article de Michèle Riot-Sarcey paru dans ENTRELESLIGNESENTRELESMOTS, le 1/02/2022
"...Là, à mon sens, se trouve l’explication de l’ascension fulgurante du journaliste du Figaro auprès d’un électorat de bourgeois parvenus à une certaine aisance qui n’attendait qu’une voix pour faire entendre la sienne. Ne nous y trompons pas, Zemmour est très éloigné d’un public populaire dont une part non négligeable s’est réfugiée dans les bras du lepénisme. Le chemin emprunté par les adeptes du récit national zélateur du rejet de l’autre n’a jamais été refermé. Il demeure tapi dans l’ombre d’une République construite sur une série d’impensés. Parmi lesquels : la liberté de tous, l’égalité réelle entre les individus, le respect de l’autre, quelles que soient ses origines...."
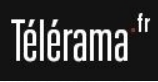
“Kiffe ta race”
Reproduit d'après TELERAMA du 28/10/2021
En France, on dit « ethnie », « multiculturel », « origine », « typé ». Mais surtout pas « race », ce « gros mot ultime » qui a été supprimé de la Constitution en 2018. Sarah Mazouz, sociologue chargée de recherches au CNRS invitée de cet épisode, livre au micro de Rokhaya Diallo et Grace Ly le fruit de ses recherches sur l’origine historique de ce tabou contemporain.
Engagée, son analyse revendique aujourd’hui haut et fort l’utilité de cette notion, « à l’américaine » : non pas dans son acception biologique, politique et morale, lourdement chargée d’histoire, mais « au singulier » pour décrire la réalité des discriminations et des rapports de pouvoir qui existent dans la société. « On ne veut pas admettre que le racisme joue autrement, à travers un fonctionnement structurel, ordinaire », estime la chercheuse. Dans un paysage médiatique où ce débat est électrique, on apprécie le ton posé de cette discussion informée, qui prend le temps de la précision.
- Ecouter ICI

Face aux discriminations
La "Vie des Idées" a publié, le 13 septembre 2021, une recension à propos du livre de Julien Talpin, Hélène Balazard, Marion Carrel, Samir Hadj Belgacem, Sümbül Kaya, Anaïk Purenne, Guillaume Roux, L’épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires
L’expérience des discriminations a un impact direct sur la santé physique et psychique des individus dont elle fragilise l’estime de soi et limite les opportunités. Les habitants des quartiers réagissent quotidiennement à cette épreuve et se mobilisent politiquement pour y faire face.
À l’heure où resurgit le débat politique et scientifique sur les questions raciales, L’épreuve des discriminations offre un travail salutaire sur ce que les expériences discriminatoires font aux habitant·es des quartiers populaires. L’ouvrage se propose de mettre en lumière la souffrance sociale et les résistances ordinaires comme collectives de celles et ceux qui sont confronté·es à des traitements inégalitaires du fait de leurs origines, leur couleur de peau ou leur religion. Pour ce faire, il mobilise un corpus de 245 entretiens, adossé à des observations ethnographiques dans six villes de France (Blanc-Mesnil, Grenoble, Lormont, Roubaix, Vaulx-en-Velin, Villepinte) et sur trois terrains miroirs effectués à l’étranger (Londres, Montréal, Los Angeles)....

Faut-il abattre les statues des hommes illustres ?
La "Vie des Idées" a publié, le 8 septembre 2021, une recension à propos du livre de Jacqueline Lalouette, Les statues de la discorde
On les pensait muettes et endormies ; voilà qu’elles se réveillent et se mettent à parler. Dans la torpeur de l’été 2020, des dizaines de statues d’hommes illustres ont été bariolées, graffées, amputées ou détruites aux quatre coins du monde. L’historienne Jacqueline Lalouette a mené l’enquête.
Cet ouvrage consacré aux destructions des statues dans l’après-Georges Floyd – ce citoyen afro-américain étouffé par un policier – a toutes les apparences d’un texte de circonstance. Rédigé pendant l’été 2020, il a été publié aux presses des Passés composés qui œuvrent à « diffuser les réflexions des historiens au sein de la cité ». Dans le sillage des travaux de Maurice Agulhon, Jacqueline Lalouette, spécialiste de la laïcité et de l’anticléricalisme en France, avait déjà consacré en 2018 un imposant ouvrage à la statuophilie du XIXe siècle : Un peuple de statues. La célébration sculptée des grands hommes (1804-2018).....
Nouveau paragraphe

Rapports interculturels et tyrannie des minorités
Un article de Gérard Bouchard dans le quotidien québécois LE DEVOIR - 26 juin 2021
Historien, sociologue, écrivain et enseignant à l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes en histoire, sociologie/anthropologie, science politique et coopération internationale. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs.
Depuis quelque temps, on peut lire et entendre que la majorité francophone au Québec serait désormais, comme d’autres majorités culturelles, l’otage des minorités. Ces dernières pèseraient indûment sur les choix de l’État et les orientations du débat public. Elles érigeraient des privilèges en droits inaliénables. Elles auraient même instauré un tabou qui empêcherait l’expression d’opinions dissidentes. Le pluralisme serait ainsi devenu un fondamentalisme, une orthodoxie intolérante. En somme, l’ancienne tyrannie de la majorité dont parlait Tocqueville se serait inversée...

Alain Policar, sur « l’inquiétante familiarité de la race »
Un entretien sur NONFICTION.fr du 6 juin 2021
Alain Policar présente dans cet entretien son dernier ouvrage, « L’inquiétante familiarité de la race. Décolonialisme, intersectionnalité et universalisme » (2020).
"Dans son dernier livre, Alain Policar s’inquiète de ce qu’il nomme « l’extension du domaine de la race », autrement dit de la volonté de certains auteurs, pour la plupart appartenant au courant décolonial, de donner une nouvelle légitimité au concept de race en tant que donnée de la génétique. La recherche de l’ascendance biogéographique, laquelle correspond au besoin de connaître ses racines, participe de l’exaltation des identités dont Amin Maalouf a montré qu’elles ne pouvaient être que meurtrières...."
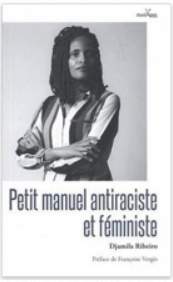
Je ne me suis pas découverte Noire, j’ai été accusée de l’être
Une note de présentation du livre de Djamila Ribeiro "Petit manuel antiraciste et féministe" sur le blog "entreleslignesentrelesmots.blog", le 4 mai 2021
Le racisme ne se combat pas avec de belles paroles mais à travers une formation et une transmission de savoirs et de pratiques indispensables ».
Dans sa préface, « Pour une pédagogie féministe et antiraciste », Françoise Vergès souligne l’importance des « manuels d’éducation populaire, de pédagogie féministe non-élitiste, de formation à la résistance et à l’autonomie ». Elle aborde, entre autres, les mécanismes de racisme d’Etat et du racisme structurel,...

"Il paraît qu’une statue, ça ne se déboulonne pas"
Dans Bibliobs du 16 avril 2021
"Il paraît qu’une statue, ça ne se déboulonne pas. Peut-être. Mais enfin, savoir ce qu’il y a derrière les bustes et les patronymes qui ont constitué le décor de notre enfance, tout de même, c’est intéressant. Prenez Colbert, auquel nous ne nous étions jamais vraiment intéressés, jusqu’à ce que Jean-Marc Ayrault propose de débaptiser la salle qui porte son nom à l’Assemblée nationale. La réalisation du Hors-Série de « l’Obs » sur « la France esclavagiste » nous l’a fait redécouvrir, ce bon vieux Colbert, en nous plongeant dans l’histoire fiscale du XVIIe siècle. Et là, on en a appris de belles.
Colbert : que savons-nous de lui, nous qui sommes allés à l’école avant les années 2000 ? En gros, que sous Louis XIV, il fut ce premier ministre efficace et travailleur notamment grâce à sa « politique mercantiliste ». Mercantiliste ? Il est tout de même étonnant qu’en 2021, un manuel moderne de Seconde Générale (on a pris, au hasard, celui édité par Belin) utilise cette expression sans éprouver le besoin d’en donner le contenu : le mercantilisme, c’est le commerce, mais le commerce de quoi ? Eh bien, notamment le ..."
Nouveau paragraphe

Race et sciences sociales – essai sur les usages publics d’une catégorie
Un article de "ENTRE LES LIGNES ENTRE LES MOTS" à propos du livre de Noiriel et Beaud : "Race et sciences sociales – essai sur les usages publics d’une catégorie (avril 2021)
Au début de la conclusion de leur livre, S. Beaud et G. Noiriel écrivent :
« Si nous avons consacré tout un livre à cet enjeu à la fois scientifique et politique de la question raciale dans la France contemporaine, en sachant à l’avance que sa réception dans notre milieu des sciences sociales sera largement biaisée par le climat passionné, voire éruptif (et de ce fait fort peu propice au débat scientifique) qui règne sur ce sujet depuis quelques années, c’est bien parce que l’accent mis, souvent de manière exclusive, sur ce mode de catégorisation du monde social dans l’espace public nous paraît constituer aujourd’hui une forme d’impasse pour le combat en faveur de l’émancipation, tant sur le plan de la science sociale elle-même que sur le plan politique ». ...

« Repentance » : l’histoire d’un mot écran
Sur une notion employée par l’Elysée à propos du rapport Stora - articles publiés le 19 février 2021 (modifié le 20 février 2021) sur le site « Histoire coloniale et postcoloniale » créé en 2017
"Il n’y aura « ni repentance, ni excuses » : telle fut, dans la bouche de Bruno Roger-Petit, l’actuel conseiller mémoire du président Macron, la première réaction de l’Elysée au rapport de l’historien Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre d’Algérie, avant même sa remise officielle, le 20 janvier 2021. « Repentance » : l’usage officiel de ce mot est lourd de signification et ne peut qu’inquiéter ceux qui militent pour la reconnaissance de ce que fut le colonialisme. Rappelons que cette notion aujourd’hui banalisée dans le débat public français a une histoire : empruntée au vocabulaire religieux, elle fut introduite dans les années 2000 comme repoussoir par des courants politiques nationalistes amateurs de roman national, désireux de réhabiliter la colonisation et de disqualifier toute histoire critique de cette dernière, avant d’être consacrée sous Nicolas Sarkozy...."

Maghrébin, une catégorie imaginaire ?
Un article de Sarah Boisson , le 26 janvier 2021 dans "La vie des idées"
Alors qu’une nouvelle loi de lutte contre le séparatisme communautaire émerge au sein du gouvernement français, cet essai revient sur une dénomination, tantôt stigmatisante, tantôt identitaire, qui désigne en France les immigrants d’Afrique du nord et leurs descendants.
Qu’entend-on par « Maghrébin.es » ? Le premier sens proposé sur le site du Centre national des Ressources textuelles et lexicales (CNRL) est la suivante : « Celui, celle qui est originaire de cette région, qui y habite ». Il s’agit là du substantif, qui désigne des habitants de la région dite du « Maghreb ». Alors qu’en tant qu’adjectif, ce terme signifie : « ce qui se situe dans cette région. (…) qui est propre à cette région ...

La pensée blanche - on ne naît pas Blanc, on le devient
La recension du site "ENTRELESLIGNESENTRELEMOTS.blog" à propos du dernier livre de Lilian Thuram. (22/12/2020)
"Je vous l’avais promis, je reviens aujourd’hui sur le livre de Lilian Thuram, paru en octobre, La pensée blanche.
Je vous avais, pour vous appâter, cité deux anecdotes de l’introduction, qui montrait à quel point si les Blancs pensaient les Noirs comme Noirs, ils ne se pensaient pas comme Blancs, mais comme normaux, et même figures de l’universel.
Car Lilian Thuram, reprenant de façon méthodique le pendant de la formule de Simone de Beauvoir – « on ne naît pas femme, on le devient » – , formule qui progressivement est comprise mais difficilement acceptée par la pensée dominante masculine, affirme ce qui devrait être aussi compréhensible par la pensée dominante blanche – on ne naît pas Blanc, on le devient...."
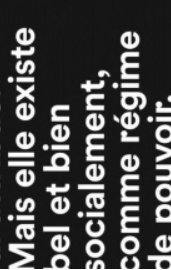
Racisme partout, race nulle part
Un article de Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à University College London - Royaume-Uni à propos du livre de sarah Mazouz "RACE" (16 décembre 2020 in www.contretemps.eu)
"Comment parler concrètement de racisme dans un pays qui réfute le mot même de « race » ? C’est, en substance, la question que pose le livre de Sarah Mazouz, sociologue et chargée de recherches au CNRS, qui s’intitule tout simplement Race, et dont on pourra lire un extrait ici. Ce court ouvrage a été rédigé et publié dans la période qui recouvre l’assassinat de George Floyd par un policier blanc à Minneapolis, les marches pour Adama Traoré, décédé après une interpellation de la police en région parisienne, et le débat sur le « séparatisme islamiste » amorcé par le gouvernement. Le contexte politique est intéressant car il fournit un terrain fertile pour débattre de la « race », non sous un angle biologique et donc raciste, mais pour comprendre celle-ci comme une construction sociale et un instrument de domination...."
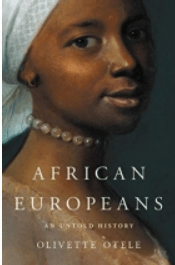
« Il y a une histoire commune entre Africains et Européens, faite de brutalité mais aussi d’échanges »
Un entretien avec Olivette Otele, professeure d’histoire à l’université de Bristol, dans LE MONDE du 15/12/2020
Elle est l’auteure d’« African Europeans », un livre qui retrace la présence des Noirs en Europe depuis plus de deux mille ans.

La race, une fragilité républicaine
A propos du livre de Omar Slaouti et Olivier Le Cour Grandmaison (dir.), Racismes de France, La Découverte. Article paru dans LA VIE DES IDEES, le 3 décembre 2020.
Alors que les débats autour de la notion de race occupent les médias, la question reste mal formulée ou masquée par le credo républicain. Un ouvrage collectif invite à déconstruire le racisme sous-jacent à l’universalisme apparent.
Les débats autour du concept de race ont occupé une place médiatique importante ces derniers mois jusqu’à atteindre un niveau jamais égalé auparavant. Pourtant, certains critiquent la persistance d’un tabou autour de cette question en France. Pourquoi ?
Olivier Le Cour Grandmaison et Omar Slaouti expliquent en introduction du présent ouvrage que si cette question raciale est de plus en plus souvent abordée dans les débats publics, elle reste bien souvent mal formulée, lorsqu’elle n’est pas simplement balayée de la main sous l’argument d’un républicanisme aveugle aux différences . Les vingt-six contributeurs de l’ouvrage veulent donc se positionner dans une controverse non seulement académique, mais surtout publique afin de donner des arguments en faveur d’une utilisation plus récurrente des outils issus des racial studies et des cultural studies. Les auteurs lancent un appel à penser, déconstruire et à résister afin de s’opposer à l’ordre raciste, patriarcal, néolibéral, entre autres (p. 21). Le présent ouvrage propose donc des formulations de la problématique raciale en France aujourd’hui qui n’ont pas toujours l’occasion d’être exposées en détail auprès du grand public....

La question raciale chez les juristes américains
Autour des critical race theories (article paru dans LA VIE DES IDEES, le 27/11/2020)
Faut-il prendre pour acquis que le droit est un vecteur du progrès social ? Élaborées aux États-Unis depuis les années 1970, les Critical Race theories ouvrent une autre voie, mais restent peu connues en France, notamment parce qu’elles inscrivent la notion de race au cœur de leur réflexion.
En 1954, l’arrêt Brown v Board of Education rendu par la Cour Suprême met fin à la ségrégation scolaire. Dix ans plus tard en juillet 1964, le Congrès vote le Civil Rights Act qui interdit toutes formes de discriminations raciales, religieuses, ou fondées sur la nationalité. Au cours de l’année 1965, sont adoptés successivement le Voting Rights Acts (restreignant toute entrave au droit de vote, en particulier dans le Sud) ainsi qu’un décret sur l’Affirmative Action (discrimination positive). Le président Lyndon Johnson, soutenu par une grande partie de la gauche américaine (liberals) propose un nouvel idéal, la « Grande société », celle qui entend mettre un terme à l’exclusion et à la pauvreté. Cet idéal repose lui-même sur un pacte social républicain renouvelé où chaque individu disposerait, théoriquement du moins, d’une égale opportunité des chances. En mettant fin d’un point de vue juridique à plusieurs siècles de ségrégation raciale et de discrimination, les États-Unis tournaient symboliquement la page de la discrimination raciale . La Cour Suprême, présidée par le juge E. Warren, voyait son prestige symbolique rehaussé, même si, on l’oublie souvent, nombreux furent les juristes qui estimèrent – souvent pour des raisons racistes dissimulées derrières des arguments formels de non-respect des compétences constitutionnelles – qu’elle était allée beaucoup trop loin dans ses prérogatives....
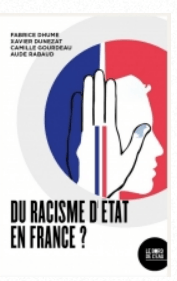
France : complexité et diversité du racisme
Article publié le 20 novembre 2020 sur le site "entreleslignesentrelesmots.blog" par les quatre auteurs (Fabrice Dhume, Xavier Dunezat, Camille Gourdeau, Aude Rabaud) du livre DU RACISME D'ETAT EN FRANCE ?
"Les mobilisations antiracistes et contre les violences policières surgies après le confinement ont donné une grande visibilité à des termes ou expressions jusque-là cantonnés dans certains espaces. « Racisé-e-s », « privilège blanc », « blanchité »… « Racisme d’État » fait partie de ces expressions qui ont acquis une nouvelle visibilité, alors que le terme est utilisé depuis de longues années. Comment en retracer la genèse ? ..."

Deux articles à propos du livre "Partages de la perspective"
A propos du livre d'Emmanuel Alloa "Partages de la perspective".
1*- La perspective et le réel : Un article paru le 22 juillet 2020 sur le site ENATTENDANTNADEAU.fr
Vingt ans après Le partage du sensible de Jacques Rancière, Emmanuel Alloa publie Partages de la perspective, et il en déplace d’emblée le point de vue. Selon lui, la définition d’une visibilité en commun passe en effet aujourd’hui par la défense d’une perspective commune, dont son essai rappelle les fondements historiques et tâche de pointer les promesses, d’asseoir la place dans les débats actuels.
2*- Éloge du singulier : Un article paru le 23 avril 2021 sur le site LAVIEDESIDEES.fr
Dépassant l’alternative entre universalisme et relativisme, Emmanuel Alloa plaide pour le perpectivisme et la singularité. Plongée philosophique, historique et artistique.
Et si le fait d’occuper une place particulière et personnelle dans le monde était gage d’une meilleure compréhension de celui-ci ? Dans son dernier ouvrage, Partages de la perspective, le philosophe Emmanuel Alloa nous invite à reconsidérer positivement la singularité, en dépassant l’habituelle confrontation entre universalisme et relativisme....

J'étouffe
Un article de Raoul Peck dans "LE 1", le 17 juin 2020
"Ce matin en me levant, j'étais déjà brisé. Il y a eu tant de matins comme celui-là.
Et chacun de ces matins laisse des traces. Des traces qui s'accumulent. Puis, ces cauchemars en soleil, qui reviennent à chaque déflagration.
Ce qui se pass en ce moment aux Etats-Unis me trouble à la nausée..."
"La pensée de James Baldwin reste un choc"
Un entretien avec Raoul Peck (RTS, le 20 mars 2017)
Primé à Toronto et Berlin, nommé aux Oscars, grand succès public aux Etats-Unis, le documentaire "Je ne suis pas votre Nègre", de Raoul Peck, vient de remporter à Genève le Prix Gilda Vieira de Mello lors du Festival international et forum sur les droits humains (FIFDH). Avec ce film, Raoul Peck remet au goût du jour la pensée d'un grand écrivain noir disparu en 1983, James Baldwin, qui analyse la question raciale aux Etats-Unis avec une acuité exceptionnelle. "Les textes de Baldwin ont changé ma vie, explique Raoul Peck. Aujourd'hui, sa pensée reste un choc."

L'urgence de l'intersectionnalité
Conférence de Kimberlé Crenshaw (octobre 2016)
Aujourd'hui plus que jamais, il est important de considérer bravement la réalité des préjugés de race et de sexe -- et de comprendre comment les deux peuvent se combiner pour faire encore plus de mal. Kimberlé Crenshaw utilise le terme « intersectionnalité » pour décrire ce phénomène ; comme elle le dit, si vous êtes sur le chemin de multiples formes d'exclusion, vous avez plus de risques d'être touché par plusieurs. Dans cette présentation émouvante, elle nous appelle à témoigner de cette réalité et à défendre les victimes de préjugés.
Kimberlé Williams Crenshaw,
née en 1959 à Canton, est une féministe américaine majeure de la critical race theory, juriste et professeure à la UCLA School of Law et à la Columbia Law School, spécialisée dans les questions de race et de genre ainsi qu'en droit constitutionnel