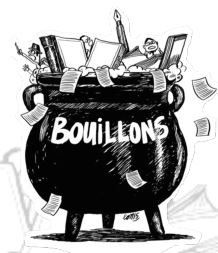Christine Tharel
est née en 1953 à Dieppe et vit en Anjou.
Bibliothécaire chargée du fonds littérature puis responsable de la programmation culturelle des Bibliothèques d'Angers, elle a toujours aimé lire, transmettre, partager ses lectures, rencontrer et échanger avec les auteurs.
Elle est heureuse aujourd'hui de partager cette passion au sein des « Bouillons » dont elle a rejoint l'équipe en 2019.

Trois questions à
A l'occasion de la parution du programme de la saison 2023-2024 des BOUILLONS, Christine Tharel (avec Catherine Malard) répond aux questions de Le dire et l'Ecrire
- L'entretien ICI
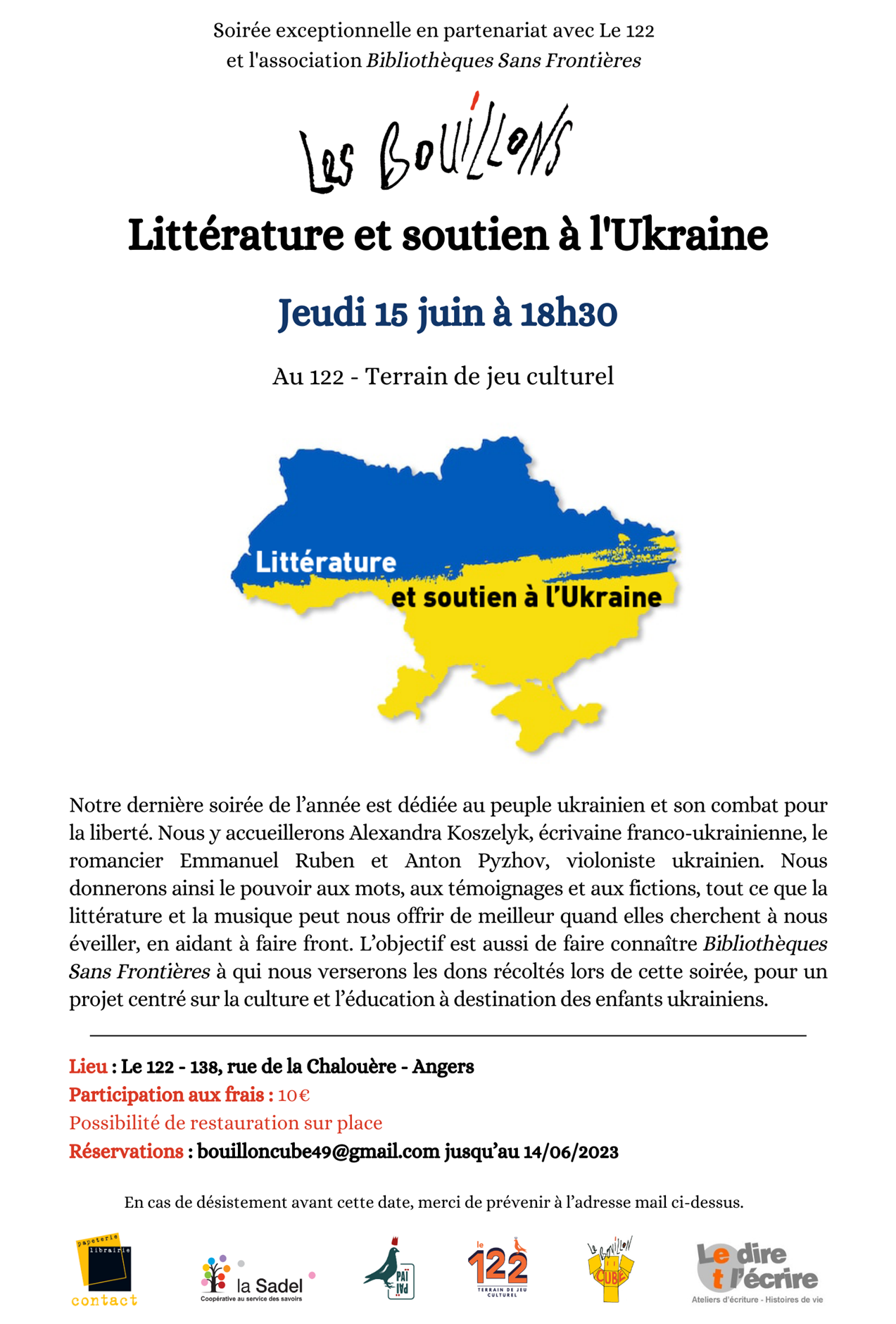
"La littérature est une façon de s'engager"
A l'occasion des "Bouillons" du 15 juin 2023 sur l'UKRAINE, un entretien dans le Courrier de l'Ouest du 13 juin 2023
avec Christine Tharel et Catherine Malard
- Lire
ICI
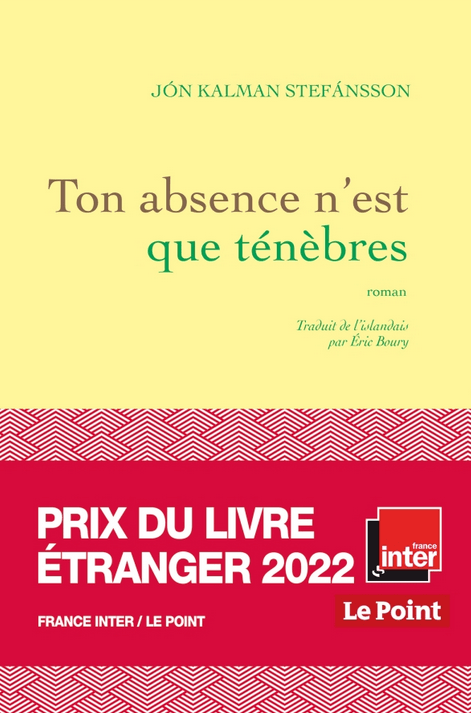
Ton absence n’est que ténèbres
(Jon Kelman Stefansson)
Lire un roman de l'auteur islandais Jon Kelman Stefansson est une expérience inoubliable, un voyage dont on ressort un peu perdu, bouleversé et poursuivi par les questionnements qui ne cessent de traverser les personnages. Avec Ton absence n'est que ténèbres, prix du Livre étranger 2022, ce conteur hors pair nous entraîne encore plus loin et plus fort.
L'histoire se passe dans un fjord entouré de montagnes dans l'Ouest de l'Islande. On est en 2020, un homme se retrouve dans une église sans savoir comment il est arrivé là ni pourquoi. Non seulement il est perdu mais il est amnésique. Il a pour seule certitude d'avoir aimé et de l'avoir été en retour. Tout le monde semble le connaître mais il n'a aucun souvenir de celles et ceux qu'il croise. Toutes les rencontres qu'il fait au cours de cette journée lui parlent de lui et vont l'aider à percer les mystères de son identité. C'est une mosaïque de récits retraçant la vie des habitants du fjord sur 120 ans qui va se déployer et lui redonner une mémoire comme on reconstitue un puzzle. A ses côtés, celui qui l'accompagne tout au long du roman, un étrange « pasteur-chauffeur de bus », l'exhorte à écrire ces histoires qui lui sont relatées.
« Je ne suis pas un auteur qui réussit à faire des plans, parce que mes livres se mettent à exister pendant que je les écris »
La construction du roman fascine, qui nous fait ainsi naviguer d'un personnage à l'autre, d'une époque à l'autre. Le lecteur voyage avec le narrateur amnésique et est embarqué lui aussi dans cette quête mémorielle. Dans ce roman, Il est question des difficultés de l'existence, de coups de foudre ou d'amours impossibles, de vies laborieuses aux confins du monde, de choix douloureux -partir ou rester ? - de faiblesse et de forces, de responsabilité, de courage ou de lâcheté, d'échecs, et parfois aussi d'improbables rencontres, source de joie et de renaissance. Le propos de l'auteur est universel, empreint d'humanité et on se laisse porter par ces récits de vies si lointaines et finalement si proches des nôtres.
Les titres de chapitres ou de paragraphes donnent le ton, intriguent, apportent fantaisie, mystère, poésie et humour.
« Vous êtes toujours vous bien qu'entièrement dissemblable – il y a encore malgré tout dans cet univers quelques raisons de rire », « Même les défunts sourient et moi je suis vivant » ou encore « Ce qui échappe à notre entendement rend le monde plus vaste ».
Et comme il semble que dans ce fjord, tout le monde écoute de la musique, pop, jazz, rock sont omniprésents. Une Play List intitulée La camarde, accompagne le récit. Les textes des chansons de Léonard Cohen, Nick Cave, Ella Fitzgerald, Les Beatles, Edith Piaf ou encore Tom Watts font partie intégrante du récit qu'elles viennent enrichir de leur tonalité, tantôt nostalgique, tantôt mélancolique ou légère.
Ce livre est aussi une hymne à tous ces récits qui irriguent nos vies, nous sont indispensables et nous rendent si précieuses littérature, poésie et musique.
«Ecrivez. Et nous n'oublierons pas.
Ecrivez. Et nous ne seront pas oubliés.
Ecrivez. Parce que la mort n'est qu'un simple synonyme de l'oubli ».
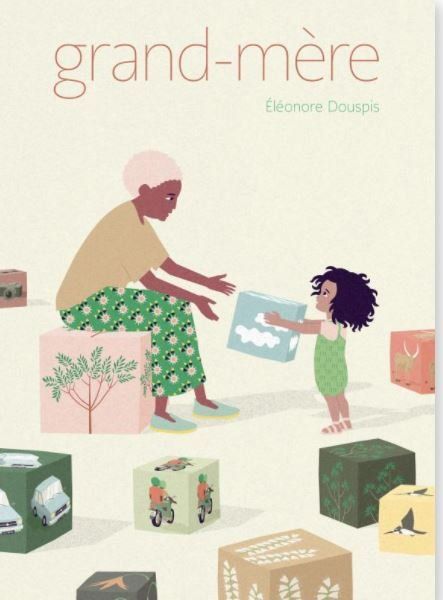
Grand-mère
Une présentation du livre de Eléonore Douspis "Grand-Mère""L'album commence par une double page assez énigmatique.
Deux enfants et leurs parents manipulent des cubes sur lesquels sont imprimés des images et objets du quotidien : une maison, des animaux ou des plantes, un bidon, une voiture. Sur la double page suivante, les enfants apportent ces cubes à leur grand-mère et l'interrogent. Puis on comprend qu'il s'agit des souvenirs qui se sont envolés, dispersés et que la mémoire de vieille dame est en miettes, parcellaire, comme cette maison en ruine. Mais au milieu de ce paysage morcelé, des mots affleurent qui font naître de délicates images. Alors la grand-mère raconte aux petits un souvenir de sa vie d'avant, puis une anecdote surgit. Les souvenirs sont fugaces et volatiles mais ils ont été transmis. On comprend que les enfants, eux, ne les oublieront pas et c'est ce qui importe. On retrouve dans cet album le graphisme délicat et précis d'Eléonore Douspis, les tonalités pastels, une mise en page très créative, le goût pour le pop-up qui de livre en livre font sa pâte et imposent un style bien à elle. Un album fort et émouvant qui aborde de manière sensible et juste, poétique et douce la question de la perte de la mémoire et du vieillissement".(20/11/2021)
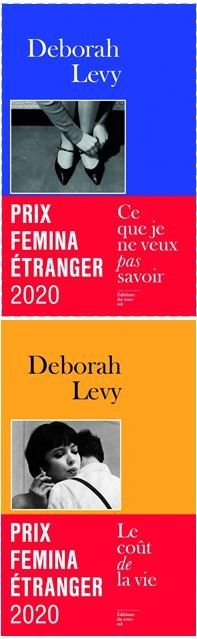
Deborah Levy : « Ce que je ne veux pas savoir » et « Le coût de la vie »
Note de lecture - 29/03/2021
Deborah Levy, romancière, dramaturge et poétesse britannique s'est fait connaître du public français en publiant à la rentrée 2020 « Ce que je ne veux pas savoir » et « Le coût de la vie » , deux livres pour lesquels elle a obtenu le prix Fémina étranger.
Dans les deux premiers tomes de son « Autobiographie vivante » qu'elle qualifie « d'auto-confession » et de « mémoires involontaires », elle revient sur sa vie de femme et d'écrivaine, une double émancipation, à la fois féminine et littéraire.
Dans « Ce que je ne veux pas savoir », Déborah Levy fuyant une vie personnelle compliquée et déprimante, séjourne à Palma de Majorque. Elle repense à son enfance en Afrique du Sud, à l'Apartheid, aux années de prison de son père militant de l'ANC, au départ pour l'Angleterre, terre d'exil avant de devenir pays d'adoption. Elle évoque son adolescence dans ce pays qu'elle apprend à aimer ainsi que ses premiers textes, griffonnés sur des serviettes en papier, dans un pub où elle se réfugie chaque samedi matin.
Dans « Le coût de la vie », on la retrouve à 50 ans, londonienne, tout juste divorcée, et se remettant d'une dépression. Elle est résolue à reprendre sa vie en main et à reconstruire avec ses filles, une vie qui lui appartienne vraiment. Un nouveau foyer dans lequel se sentir bien, un lieu où écrire, de nouveaux amis, de nouveaux souvenirs, vont être autant de façons de reconquérir son identité.
Deborah Levy questionne tour à tour son identité de femme et d'écrivaine. Comment devenir une femme libre quand on a été conditionnée à n'être qu'un personnage secondaire ?
Comment devenir écrivaine quand on peine à prendre la parole ? Elle le devient nous dit-elle quand à l'adolescence, elle parvient à exprimer ses pensées, « à parler à voix haute, à voix très haute, pour revenir ensuite à ma propre voix ». Et c'est quand elle a enfin « une chambre à soi », un cabanon au fond du jardin qu'elle s'autorise la première personne, un « je qui m'est proche sans être moi pour autant ».
« L'écriture est une question de regard, d'attention, d'écoute accordée au monde »
L'originalité et le charme de ces deux livres tiennent à la façon dont Deborah Levy mêle anecdotes du quotidien, souvenirs, portraits, récits, flash-back, réflexions sur la condition féminine, références à des auteurs qui l'ont inspirée (Marguerite Duras, Virginia Wolf, Simone de Beauvoir). Et comment au-delà d'un désordre apparent, elle nous entraîne, subtilement, dans les plis de sa mémoire, dans le flux de sa pensée, restituant ainsi de façon remarquable toute la complexité et la richesse d'une vie.
C'est à la fois juste, lumineux, foisonnant et décapant, plein de vie et d'humour. Une invitation à « exprimer ses pensées à voix haute, assumer ses désirs, être dans le monde plutôt que le laisser nous abattre ».
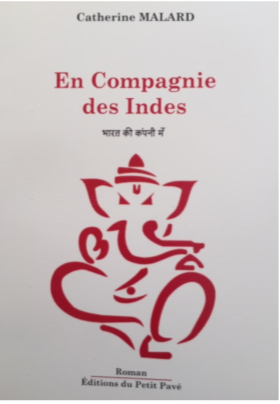
Le nouveau roman de Catherine Malard, En compagnie des Indes, est à la fois un roman initiatique et un récit de voyage. Une belle porte d'entrée sur ce pays de légende.
Une note - mars 2019
Catherine Malard vit et travaille sur les bords de Loire. Elle écrit des fragments, des nouvelles, et a publié trois romans aux éditions du Petit Pavé. Avec ce dernier roman, paru en décembre 2018, elle met le cap sur l'Inde.
En 2014, Anouk, la narratrice, retourne en Inde où elle a déjà effectué un séjour d'un an, 38 ans auparavant. La perspective de ce retour éveille en elle le souvenir de ce premier voyage. Elle avait alors une vingtaine d'années, et l'envie de quitter la douceur des bords de Loire pour les rives du Gange la tenaillait, envers et contre tout, malgré l'incompréhension de sa famille et de ses amis de fac. Il suffit d'une pincée de curcuma pour la transporter, et nous avec, 40 ans en arrière :
“Ce matin je déplie mes souvenirs indiens comme si j'avais subitement mis la main au fond d'une corbeille emplie de papiers empoussiérés que ma mémoire aurait chiffonnés pour mieux oublier. Comment recoudre ces mots éparpillés sur des petits carnets élimés, renouer avec les courriers fanés de Camille, l'amie qui n'avait pas voulu m'accompagner, comment faire parler les photos noir et blanc, ranimer les portraits d'amis oubliés ou disparus.”
Anouk évoque d'abord le choc culturel ressenti à son arrivée, les premières impressions qui bousculent ses repères, la déstabilise et lui donne envie de fuir. “Tout me glisse entre les doigts... Comme tout me heurte moi qui cherchait partout du sens!” écrit-elle à son amie Camille...